 |
Distance (années) |
Évènements |
 |
10 000-15 000 |
La supergéante rouge Antarès peut exploser en supernova[réf. nécessaire]. |
 |
36 000 |
La naine rouge Ross 248 devient l'étoile la plus proche du Soleil, à environ 3,024 années-lumière[6]. |
 |
42 000 |
Alpha Centauri redevient le système stellaire le plus proche du Soleil (plus précisément Proxima Centauri l'étoile la plus proche) après l'éloignement de Ross 248[6]. |
 |
50 000 |
L'actuelle période interglaciaire se termine, d'après les travaux de Berger et Loutre[7], renvoyant la Terre dans une nouvelle période glaciaire, en supposant limités les effets du réchauffement climatique.
Les chutes du Niagara érodent les 32 km qui les séparent actuellement du lac Érié et cessent d'exister[8]. |
 |
50 000 |
La longueur du jour solaire atteint 86 401 secondes, à cause des forces de marée lunaires freinant la rotation de la Terre. Selon le système actuel, une seconde intercalaire devrait être alors ajoutée aux horloges tous les jours[9]. |
 |
100 000 |
Le mouvement propre des étoiles sur la sphère céleste, qui résulte de leur mouvement à travers la galaxie, rend méconnaissables la majeure partie des constellations actuelles[10].
L'étoile hypergéante VY Canis Majoris a probablement explosé en hypernova[11]. |
 |
100 000 |
La Terre a probablement connu l'éruption d'un supervolcan produisant au moins 400 km3 de magma[12]. |
 |
250 000 |
Le Kamaʻehuakanaloa, le plus jeune volcan de la chaîne sous-marine Hawaï-Empereur, s'élève au-dessus de la surface de l'océan Pacifique et devient une nouvelle île volcanique[13]. |
 |
500 000 |
La Terre a probablement été percutée par un astéroïde d'environ 1 km de diamètre, si aucune stratégie de déviation n'est mise en place[14]. |
 |
1 million |
La Terre a probablement connu l'éruption d'un supervolcan produisant au moins 2 300 km3 de magma, un évènement comparable à celle du Toba, il y a 75 000 ans[12]. |
 |
1 million |
Limite maximale pour l'explosion de la supergéante rouge Bételgeuse en supernova. Cette explosion devrait être facilement visible en plein jour[15],[16]. |
 |
1,4 million |
L'étoile naine orange Gliese 710 (0,6 masse solaire) passe à 1,1 année-lumière (70 000 unités astronomiques) du Soleil avant de s'éloigner. Ce passage dans le nuage d'Oort pourrait perturber gravitationnellement les membres de ce nuage, un halo de corps glacés orbitant à la frontière du Système solaire, augmentant la probabilité d'un impact cométaire dans le Système solaire interne[17]. |
 |
8 millions |
La lune Phobos s'approche à moins de 7 000 km de Mars, sa limite de Roche ; les forces de marées devraient la désintégrer et la transformer en un anneau de débris continuant alors à spiraler vers la planète Mars[18]. |
 |
10 millions |
La vallée du Grand Rift est envahie par la mer Rouge, créant un nouveau bassin océanique divisant l'Afrique[19]. |
 |
11 millions |
L'anneau de débris de Phobos autour de Mars atteint la surface de la planète[18]. |
 |
50 millions |
La côte californienne commence sa subduction dans la fosse des Aléoutiennes, du fait du mouvement vers le nord le long de la faille de San Andreas[20].
La collision de l'Afrique et de l'Eurasie ferme le bassin méditerranéen et crée une chaîne de montagnes similaire à l'Himalaya[21]. |
 |
100 millions |
La Terre a probablement été percutée par une météorite de taille comparable à celle ayant provoqué l'extinction Crétacé-Tertiaire il y a 66 millions d'années[22]. |
 |
230 millions |
Au-delà de cette date, la position des planètes du Système solaire sur leurs orbites, à partir de l'époque présente, est impossible à prévoir[23]. |
 |
240 millions |
Le Système solaire termine une révolution complète autour du centre galactique à partir de sa position actuelle[24]. |
 |
250 millions |
Tous les continents terrestres pourraient fusionner en un nouveau supercontinent. Quatre configurations possibles ont été proposées : Amasie, Nouvelle Pangée, Pangée prochaine[25],[26] et Aurica (en). |
 |
500-600 millions |
Un sursaut gamma, ou une supernova énorme, pourrait se produire à moins de 6 500 années-lumière de la Terre. C'est une distance suffisamment proche pour affecter la couche d'ozone et éventuellement déclencher une extinction massive, en supposant correcte l'hypothèse selon laquelle une explosion de ce genre a déclenché l'extinction de l'Ordovicien-Silurien. Toutefois, la supernova devrait nécessairement avoir une orientation très précise par rapport à la Terre pour avoir un effet néfaste dessus[27]. |
 |
600 millions |
Les forces de marée ont suffisamment éloigné la Lune de la Terre pour que les éclipses solaires totales ne soient plus possibles[28]. Toutes les éclipses solaires centrales seront alors annulaires. |
 |
800 millions |
L'atmosphère terrestre ne contient plus assez de dioxyde de carbone pour permettre la photosynthèse C4[29]. La vie multicellulaire s'éteint[30]. |
 |
1 milliard |
La luminosité solaire a augmenté de 10 %, la température moyenne à la surface de la Terre atteignant 47 °C. L'atmosphère devient une « serre humide », provoquant une évaporation instable des océans[31]. Des poches d'eau pourraient être toujours présentes aux pôles, autorisant quelques refuges pour la vie[32],[33]. |
 |
1,3 milliard |
La vie eucaryote s'éteint par manque de dioxyde de carbone. Seuls les procaryotes demeurent[30]. |
 |
1,5–1,6 milliard |
L'augmentation de la luminosité solaire provoque un déplacement de la zone habitable ; tandis que le dioxyde de carbone s'accroît dans l'atmosphère de Mars, sa température en surface augmente à des niveaux comparables à celle de la Terre pendant la glaciation[34],[30]. |
 |
2,3 milliards |
Le noyau externe terrestre se solidifie, si le noyau interne continue à croître à son rythme actuel d'1 mm par an[35],[36]. Sans noyau externe liquide, le champ magnétique terrestre s'éteint[37]. |
 |
2,8 milliards |
La température à la surface de la Terre, même aux pôles, atteint en moyenne 147 °C. À ce niveau, la vie est réduite à des colonies unicellulaires dans des micro-environnements isolés et dispersés (lacs de haute altitude, cavernes souterraines) et s'éteint partout ailleurs[38],[39],[notes 1]. |
 |
3 milliards |
Durée médiane pour que la distance de la Lune à la Terre soit suffisante pour atténuer son effet stabilisateur sur l'inclinaison de l'axe terrestre. En conséquence, le mouvement des pôles terrestres devient chaotique[40]. |
 |
3,3 milliards |
1 % de chance pour que l'ellipticité de l'orbite de Mercure devienne tellement élevée qu'elle entre en collision avec Vénus, provoquant le chaos dans le Système solaire interne et conduisant potentiellement à une collision planétaire avec la Terre[41]. |
 |
3,5 milliards |
Les conditions à la surface de la Terre sont comparables à celles de Vénus actuellement[42]. |
 |
3,6 milliards |
La lune Triton traverse la limite de Roche de Neptune, se désintégrant potentiellement en un système d'anneaux planétaires similaire à celui de Saturne[43]. |
 |
4 milliards |
Durée médiane pour une collision entre la galaxie d'Andromède et la Voie lactée, conduisant à une fusion des deux galaxies[44]. Du fait des immenses distances entre les étoiles, le Système solaire ne devrait pas être affecté par cette collision[45]. |
 |
5,4 milliards |
Après avoir épuisé ses réserves d'hydrogène dans son noyau, le Soleil quitte la séquence principale et commence son évolution en géante rouge[46]. |
 |
7,5 milliards |
La Terre et Mars pourraient être en rotation synchrone avec le Soleil[34]. |
 |
7,9 milliards |
Le Soleil atteint le sommet de la branche des géantes rouges, d'un rayon maximal 256 fois supérieur à son rayon actuel[46]. Mercure, Vénus et peut-être la Terre sont détruites[47].
Pendant cette période, il est possible que Titan, la principale lune de Saturne, puisse atteindre une température de surface compatible avec la présence de vie[48]. |
 |
8 milliards |
Le Soleil devient une naine blanche carbone-oxygène d'une masse égale à 54,05 % de sa masse actuelle[49],[46],[50]. |
 |
14,4 milliards |
Le Soleil devient une naine noire tandis que sa luminosité tombe en dessous de trois milliardièmes de son niveau actuel et sa température descend à 2 000 °C, la rendant invisible à l'œil humain[51]. |
 |
20 milliards |
Fin de l'Univers dans le cas d'un scénario de type Grand déchirement[52]. Les observations des vitesses de groupes de galaxies par Chandra suggèrent que ceci ne devrait pas se produire[53]. |
 |
50 milliards |
En supposant qu'elles survivent à l'expansion solaire, la Terre et la Lune sont en rotation synchrone, chacune présentant toujours la même face à l'autre[54],[55]. Par suite, les forces de marée du Soleil vampirisent une partie du moment cinétique du système, provoquant un raccourcissement de l'orbite de la Lune et une accélération de la rotation de la Terre[56]. |
 |
100 milliards |
L'accélération de l'expansion de l'Univers conduit toutes les galaxies en dehors du Groupe local à disparaître au-delà de l'univers observable[57]. |
 |
150 milliards |
Le fond diffus cosmologique refroidit à −272,85 °C (au lieu des −270,45 °C actuellement), le rendant indétectable avec les technologies actuelles[58]. |
 |
450 milliards |
Durée médiane pour que la cinquantaine de galaxies[59] du Groupe local fusionnent en une seule galaxie[3]. |
 |
800 milliards |
La luminosité totale de la galaxie résultante commence à décliner, tandis que les étoiles naines rouges traversent leur étape « naine bleue » de luminosité maximale[60]. |
 |
1012
(1 billion) |
Estimation basse pour la fin de la naissance des étoiles dans les galaxies, celles-ci ne comportant plus de nuages de gaz permettant leur formation[3].
L'expansion de l'Univers, en supposant une densité d'énergie sombre constante, multiplie la longueur d'onde du fonds diffus cosmologique par 1029, dépassant l'échelle de l'horizon cosmique et rendant cette preuve du Big Bang indétectable. Cependant, il est toujours possible de constater l'expansion de l'Univers par étude de la cinématique stellaire[57]. |
 |
3 × 1013
(30 billions) |
Durée estimée pour que le Soleil passe très près d'une autre étoile. Quand deux étoiles (ou rémanents d'étoile) passent près l'une de l'autre, les orbites de leurs planètes sont perturbées, ce qui peut les éjecter définitivement des systèmes. En moyenne, plus une planète orbite proche de son étoile, plus il se passe du temps avant qu'une telle éjection se produise[61]. |
 |
1014
(100 billions) |
Estimation haute pour la fin de la naissance des étoiles dans les galaxies[3]. Cette date marque la transition vers l'ère dégénérée ; l'hydrogène n'est plus disponible pour former de nouvelles étoiles et celles qui existent épuisent leur combustible puis s'éteignent[2]. |
 |
1,2 × 1014
(120 billions) |
Toutes les étoiles de l'Univers ont épuisé leur combustible (les étoiles les plus durables, les naines rouges à faible masse, ont une durée de vie entre 10 et 20 billions d'années)[3]. Après ce point, les seuls objets de masse stellaire restants sont des rémanents stellaires (naines blanches, étoiles à neutrons et trous noirs). Les naines brunes subsistent également[3]. |
 |
1015
(1 billiard) |
Des rencontres stellaires rapprochées ont fini par éjecter toutes les planètes hors du Système solaire[3].
Le Soleil s'est refroidi à 5 K au-dessus du zéro absolu[62]. |
 |
1019 à 1020 |
Toutes les naines brunes et les rémanents stellaires ont été éjectés des galaxies. Lorsque deux objets passent à proximité l'un de l'autre, ils échangent de l'énergie orbitale, les objets de moindre masse ayant tendance à gagner de l'énergie. Après des rencontres répétées, les objets de faible masse peuvent en obtenir suffisamment pour être éjectés de leur galaxie[3],[63]. |
 |
1020 |
L'orbite terrestre arrive à son effondrement final par émission d'ondes gravitationnelles[64], si elle n'a été ni engloutie par le Soleil[65],[66], ni éjectée lors d'une rencontre stellaire[64]. |
 |
2 × 1036 |
Tous les nucléons de l'Univers observable se désintègrent, si la demi-vie du proton prend sa plus petite valeur possible (8,2 × 1033 années)[67],[68],[notes 2]. |
 |
3 × 1043 |
Tous les nucléons de l'Univers observable se désintègrent, si la demi-vie du proton prend sa plus grande valeur possible (1041 années)[3], en supposant que le Big Bang a subi une inflation et que le même procédé qui a permis à la matière de prédominer sur l'antimatière conduit le proton à se désintégrer[68],[notes 2]. Si tel est le cas, l'ère des trous noirs débute là où ceux-ci sont les derniers objets célestes[2],[3]. |
 |
1065 |
En supposant que le proton ne se désintègre pas, tous les objets rigides, comme les roches, ont réarrangé leurs atomes et leurs molécules par effet tunnel. À cette échelle de temps, toute matière est liquide[64]. |
 |
1,7 × 10106 |
Estimation du temps nécessaire à un trou noir supermassif d'une masse de 20 billions de masses solaires pour s'évaporer par rayonnement de Hawking[69]. Cela marque la fin de l'ère des trous noirs. Après cette époque, si le proton se désintègre, l'Univers entre dans l'ère sombre, où tous les objets physiques se sont désintégrés en particules subatomiques, atteignant peu à peu leur état d'énergie final[2],[3]. |
 |
10139 |
Estimation de la durée de vie du modèle standard avant l'effondrement d'un faux vide. L'intervalle de confiance à 95 % est de 1058 à 10241 ans, en partie à cause de l'incertitude concernant la masse du quark top. |
 |
10200 |
Tous les nucléons de l'univers observable se sont désintégrés, si ce n'est par le processus ci-dessus, par l'un des nombreux mécanismes possibles dans la physique des particules moderne (processus de non-conservation du baryon d'ordre supérieur, trous noirs virtuels, etc.) sur des échelles de temps de 1046 à 10200 ans. |
 |
101500 |
Si le proton ne se désintègre pas, tous les baryons soit ont fusionné pour former du fer 56, soit se sont désintégrés en fer 56 depuis un élément de masse supérieure[64]. |
 |
 [notes 3] [notes 3] |
Estimation basse du temps nécessaire pour que toute matière s'effondre en trou noir, en supposant le proton stable[64]. |
 |
 |
Estimation du temps nécessaire pour qu'un cerveau de Boltzmann apparaisse dans le vide par réduction spontanée d'entropie[5]. |
 |
 |
Estimation haute du temps nécessaire pour que toute matière s'effondre en trou noir, en supposant le proton stable[64]. |
 |
 |
Estimation haute du temps nécessaire à l'Univers pour atteindre son état d'énergie final[5]. |
 |
 |
Estimation du temps nécessaire pour que des fluctuations quantiques aléatoires génèrent un nouveau Big Bang, selon Caroll et Chen[70]. |
 |
 |
Échelle de temps du théorème de récurrence de Poincaré pour l'état quantique d'une boite hypothétique contenant un trou noir stellaire isolé[71], en supposant un modèle statistique sujet à la récurrence de Poincaré[incompréhensible]. |
 |
 |
Échelle de la durée de récurrence de Poincaré pour l'état quantique d'une boite hypothétique contenant un trou noir d'une masse égale à celle de la totalité de l'Univers observable[incompréhensible][71]. |
 |
 |
Échelle de la durée de récurrence de Poincaré pour l'état quantique d'une boite hypothétique contenant un trou noir d'une masse égale à celle de la totalité de l'Univers, observable ou non, en supposant le modèle inflationnaire chaotique de Linde avec un inflaton d'une masse de 10−6 masse de Planck[incompréhensible][71]. |


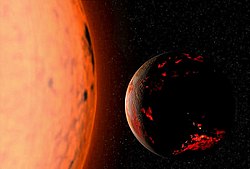

 ,
,  ...
...




