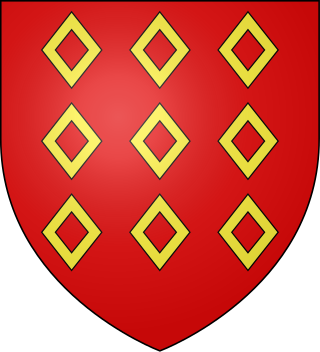Top Qs
Chronologie
Chat
Contexte
Maison de Rohan
famille noble française De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Remove ads
La maison de Rohan est une famille subsistante de la noblesse française originaire de Bretagne, tenant son nom de la seigneurie de Rohan (actuel département du Morbihan). Issue en ligne agnatique des vicomtes de Porhoët, dont la filiation attestée remonte à 1028, elle est au Moyen Âge l'une des familles les plus puissantes du duché de Bretagne.
Elle a formé plusieurs branches dont seule subsiste la branche de Rohan-Rochefort des ducs de Montbazon, ducs de Bouillon et, à la suite d'un établissement dans l'empire d'Autriche au début du XIXe siècle, des princes autrichiens de Rohan[1],[2].
À la suite de son mariage en 1645 avec Marguerite de Rohan, fille unique d'Henri II de Rohan, premier duc de ce nom, mort en 1638 sans postérité mâle, Henri de Chabot, membre de la branche aînée de la famille de Chabot, originaire du Poitou, est créé duc de Rohan en 1648 et autorisé à substituer à son nom celui de « Rohan-Chabot », donnant naissance à la famille de Rohan-Chabot[3],[4].
Remove ads
Anthroponymie
La maison de Rohan tire son nom du breton Roc'han (« petit rocher »), nom d'un lieu situé sur le site de Castennec (autrefois Castel-Noec)[5]) dans l'ancienne commune de Bieuzy (au sud de Pontivy) où le Blavet forme un méandre autour d'un promontoire rocheux, orienté nord-sud et long de 900 m, qui culmine à 75 m d'altitude, surplombant le fleuve de 40 m.
Bénéficiant de cette situation favorable, ce promontoire a connu une permanence de l'habitat du second âge du Fer au Moyen Âge[6]. Entre 1120 et 1128, un château y est édifié par le vicomte Alain de Castelnoec qui prend ensuite le nom de Rohan, devenant Alain Ier de Rohan et donnant son nom à la localité de Rohan qu'il fonde en 1127[7] à quelques kilomètres de là, à l'est de Pontivy et au sud de Loudéac.
Remove ads
Origines
Résumé
Contexte
Légendes familiales
La maison de Rohan a prétendu remonter aux rois de Bretagne, allant parfois jusqu'à se proclamer issue du roi légendaire Conan Mériadec[8]. Une autre figure de légitimation est Mériadec de Vannes, saint du VIIe siècle dont se réclamaient les ducs de Rohan[9].
Guethenoc de Porhoët (fin du Xe siècle)
Le premier ancêtre connu avec certitude est, à la fin du Xe siècle, un certain Guéthénoc[Note 1]. Bien qu'il n'ait pas été vicomte de Rennes, comme le laissent entendre de faux actes rédigés par les moines de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon[10], il pourrait être lié à l'aristocratie de la région ligérienne[pas clair] ou être issu d'un lignage breton possessionné autour de Josselin, dans le Porhoët, où il construit un château[11].
Josselin Ier de Porhoët (XIe siècle)
Le fils de Guéthénoc est Josselin Ier, vicomte de Porhoët (mort en 1074), qui, sous le règne du duc Alain III, participe à la bataille d'Hastings et à la conquête de l'Angleterre aux côtés de Guillaume le Conquérant. Il reçoit des terres dans le Bedfordshire, le Buckinghamshire et le Gloucestershire, ainsi que la ville de Caerwent.
Il est le père de Mainguy, évêque de Vannes, d'Eudon Ier, vicomte de Porhoët (mort après 1092), marié à Anne de Léon, dont il a Geoffroy, qui continue la branche aînée des vicomtes de Porhoët, bientôt éteinte.
Alain Ier de Rohan (1084-1147)
Le premier vicomte de Rohan est le troisième fils d'Eudon 1er, Alain Ier de Rohan (1084-1147), dit Alain le Noir, d'abord vicomte de Castelnoec, trouvé en 1127[pas clair], qui construit en 1127 le château de Rohan et fonde un nouveau lignage, la maison de Rohan[2].
Après l'extinction de la branche aînée de Porhoët, les vicomtes de Rohan sont vicomtes de Porhoët, reprenant ainsi le nom de l'ancien pagus carolingien où se trouve le centre de leur châtellenie de Josselin[12].
Remove ads
Histoire
Résumé
Contexte

Moyen Âge
Du XIIe siècle au XVe siècle, les Rohan n'ont de cesse de consolider et d'élargir leur assise territoriale, par alliances, acquisitions, héritage, legs, échanges. Ils rivalisent ainsi durant tout le Moyen Âge avec les ducs de Bretagne, au gré de leurs intérêts ; tantôt assurant avec loyauté les plus hautes charges du duché, tantôt en rébellion comme Jean II de Rohan, dans les dernières années de l’indépendance bretonne. Le « grand vicomte » contrôle, au faîte de sa puissance, près de 200 000 Bretons sur près d'un cinquième du territoire breton[14]. Le cœur du comté de Rohan est constitué du triangle rohannais[15] (trois grandes forteresses La Chèze, Josselin et Pontivy) qui a pour centre le village de Rohan, le fief nominal de la famille dont le château est délaissé au profit des trois autres[16].
Leurs domaines sont soumis à des lois coutumières, appelées « usement de Rohan ». La vicomté de Rohan se dote en 1280 de cette juridiction qui régit les affaires civiles et juridiques, et dont une large part est dédiée au domaine congéable ou « bail à convenant »[Note 2].
Aux immenses fiefs des Rohan et des Rieux, qui coupent en écharpe la péninsule armoricaine en deux parties égales, les ducs bretons répliquent en verrouillant l'accès aux côtes[18] et en les bloquant à l'est par les forteresses de la Marche de Bretagne, dont les places fortes sont essentiellement Rennes et Nantes[19].
Le prestige de la famille s'accroit définitivement en 1377 à la suite du mariage royal de Jean Ier de Rohan avec Jeanne de Navarre, sœur du roi Charles II.
De la guerre folle à l'acte d'union de la Bretagne (1485-1532)
Les Rohan, impopulaires dans un environnement très bretonnant (en breton, les porcs sont surnommés "Rohan" ou "Mab Rohan" ("Fils de Rohan") en représailles contre cette grande famille aristocratique, à cette époque rangée du côté des Français)[20], sont neutralisés pour un temps du moins. Ils ne sortent de l'ombre qu'avec l'appui de l'armée française lors de la campagne de 1487 de la guerre de Bretagne, marquée par les divisions des barons de Bretagne (Rohan, Rieux, Laval) et leurs changements de camp incessants[21].
Durant l'hiver 1488, Jean II de Rohan est encerclé par les troupes ducales : ses places de La Chèze, Josselin, Rohan et Pontivy tombent l'une après l'autre en . Mais en juillet, le duc François II est vaincu à Saint-Aubin-du-Cormier et meurt peu après, laissant le trône à sa fille Anne, âgée de 11 ans.
Le vicomte de Rohan espère toujours la couronne ducale pour son fils, mais échoue.
En 1491, le mariage entre Anne de Bretagne et Charles VIII amorce le rattachement du duché à la couronne de France, union qui devient définitive en 1532.
Période des guerres de religion (1562-1598)
« Deux tournants rythment l’histoire de la famille au XVIe siècle : l’extinction de la branche aînée, dont les filles sont mariées aux héritiers des branches cadettes de Gié et Guéméné, et la conversion au protestantisme d’une partie de la famille, conséquence de leur alliance avec les d’Albret ».
Les Guéméné, restés catholiques, sont récompensés de leur fidélité à Henri III et leur terre devient une principauté en 1570 avant qu’ils ne prennent le titre de duc de Montbazon en 1588.
Le duché de Rohan (1603)
L’avènement d’Henri IV (en 1589) puis sa victoire sur la Ligue alliée à Philippe II d'Espagne (1598) fait la prospérité des Rohan-Gié.
En 1603, la vicomté de Rohan est érigée en duché-pairie et le nouveau duc épouse Marguerite de Béthune-Sully, fille unique du célèbre ministre de Henri IV[Note 3].
La reprise des guerres de Religion sous le règne de Louis XIII provoque la disgrâce des ducs de Rohan. En 1629, les biens du duc sont placés sous séquestre et le duc, interdit de séjour en Bretagne, s’exile.
Mariage de Marguerite de Rohan avec Henri de Chabot
Son unique héritière, Marguerite épouse en 1645 Henri de Chabot, un lointain cousin catholique, un cadet issu d’une branche cadette du Poitou. Vue par les Rohan comme une mésalliance et une trahison, l’union est un acte politique voulu par le pouvoir royal afin d’éviter l’avènement d’un nouveau duc protestant[23].
« Le XVIIe siècle marque le retour des Rohan dans la sphère catholique et dans les réseaux curiaux[Note 4]. La famille est alors divisée en deux branches : les Rohan-Chabot et les Rohan-Rohan eux-mêmes subdivisés entre les Rohan-Guéméné, ducs de Montbazon, et les Rohan-Soubise dont la terre est érigée en principauté en 1667 puis en duché-pairie sous le nom de Rohan-Rohan en 1714. À la fin du XVIIe siècle, les Rohan sont influents à la cour grâce à leurs alliances avec les Luynes, les Ventadour, les Colbert et la maison de Lorraine[25] ».
En 1680 le duché de Rohan se compose de 6 châtellenies (Pontivy, Rohan, La Chèze, Loudéac, La Trinité, Gouarec) et s'étend sur 69 paroisses, dont une quarantaine en totalité ; son fief comprenait 257 manoirs nobles, dont ceux de Carcado et de Camors[26].
Conflit entre les Rohan-Rohan et les Rohan-Chabot (XVIIIe siècle)
Au XVIIIe siècle, les Rohan-Rohan qui veulent garder leur prééminence sur les autres branches, « intentent un procès retentissant aux Rohan-Chabot. Au cours du siècle, les écarts se creusent entre les deux branches.
Les Rohan-Rohan poursuivent leur ascension en obtenant la qualité de princes étrangers en 1758 et les plus grandes charges à la cour, dans l’armée ou dans l’Église. Ils se succèdent comme princes-évêques de Strasbourg et affirment leur pouvoir dans la pierre avec le palais épiscopal construit par Robert de Cotte entre 1732 et 1742 ou le château de Saverne. La fin du XVIIIe siècle est cependant difficile avec la faillite des Guéméné (1782) et l’Affaire du collier de la reine (1785).
Exil en Autriche des Rohan-Rohan (1815)
À la Restauration, échouant à récupérer l’héritage du prince de Condé (fils de Charlotte de Rohan), les Rohan-Rohan quittent la France et s’installent en Autriche où leur dernier représentant vit encore aujourd’hui ».
Sous la Restauration, l'héritage du prince de Condé (fils de Charlotte de Rohan) n'ayant pu être récupéré, les Rohan-Rohan quittent la France, entrent au service de l'empereur d'Autriche et s'installent sur le territoire du royaume de Bohême, une des composantes de l'empire d'Autriche. Ils y achètent le château de Sychrov, qu'ils font considérablement agrandir. La famille fait aussi construire un palais au centre de Prague (le palais Rohan).
En 1834 puis en 1835, Charles X, roi de France en exil depuis 1830, visite le château de Sychrov[27].
Le château de Sychrov ayant été utilisé par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, il est confisqué par l'État tchécoslovaque après 1945.
La dernière descendante vivante de cette branche tchèque est Margareta Rohanová, épouse Kottulinská. Après 1989, elle a assuré la promotion du château de Sychrov et son association a été active en Allemagne, en France et au Royaume-Uni[28],[29].
Les Rohan-Chabot au XIXe siècle et au XXe siècle
Les Rohan-Chabot demeurent, eux, « à la marge du pouvoir », préférant renforcer leur influence en Bretagne[30].
« Avec la Révolution et la Restauration, les Rohan-Chabot se partagent en deux tendances politiques : ultraroyaliste pour la branche aînée ; orléaniste pour la branche cadette des comtes de Jarnac.
Le second XIXe siècle annonce leur retour sur un domaine passablement amoindri depuis la Révolution et les difficultés financières (800 000 ha en 1789 et 40 ha en 1815). La réinstallation à Josselin et sa restauration à partir des années 1860 atteste du « réancrage des Rohan en Bretagne » où ils se lancent dans la vie politique.
Alain de Rohan-Chabot, député royaliste et catholique du Morbihan pendant 38 ans, maire de Josselin de 1882 à 1914, poursuit les travaux à Josselin.
La mort d’Alain de Rohan-Chabot en 1914 et de son fils Josselin en 1916 interrompent cette époque fastueuse et la famille doit faire face « aux défis contemporains », ce qui passe par l’entrée dans le monde du travail et l’ouverture du château au public.
C’est aussi une rupture sur le plan politique car il faut attendre les années 1960 pour que les Rohan s’engagent dans le camp gaulliste. Josselin de Rohan devient une figure politique locale indétrônable : il est maire de Josselin (1965-2000), conseiller régional (1982-1998), président de la région Bretagne (1998-2004) et sénateur (1983-2011)[31] ».
Remove ads
Arbre généalogique de la Maison de Rohan
Résumé
Contexte
Maison de Rohan (issue d'Alain, 1er vicomte de Rohan dans les années 1120, fils puîné d'Eudon de Porhoët ; son frère aîné Geoffroi continue la maison de Porhoët, dont un rameau cadet forme la branche des barons Zouche) │ │ │ │─────────────────>
branche aînée de Rohan (†), jusqu'à la vicomtesse Anne de Rohan (1485-1529), épouse en │ │ 1515 de Pierre II de Rohan-Gié │ ├──>
branche de Rohan-Guéméné (†) │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──>
branche de Rohan-Rochefort │ │ │ │ │ │ │ └──>
branche de Rohan-Soubise (†) │ │ │ │ │ └──>
branche de Rohan-Gié (†), jusqu'à Henri II (duc de Rohan en 1603) et sa │ │ │ fille Marguerite, mariée à Henri Chabot en 1645 │ │ └──>
maison de Rohan-Chabot (issue des Rohan en ligne féminine) │ │ │ └──>
branche de Rohan-Gué-de-l'Isle (†) │ │ │ └──>
branche de Rohan-Polduc (†) │ └──>
branche de Rohan-Montauban (†)
Généalogie générale de la Maison de Rohan
Guéthénoc († après 1021), probablement vicomte de Rennes ; son ascendance est inconnue[24]. x Alarun de Cornouaille │ └──> Josselin Ier de Porhoët (v. 1032-1074), vicomte de Bretagne, de Rennes et de Porhoët x ? │ └──> Eudon Ier de Porhoët (???? – après 1092), vicomte de Porhoët et de Rennes x Emma de Léon[32] (???? – 1092) │ └──> Alain de Porhoët dit « Alain Ier de Rohan le Noir » (1084-1147), vicomte de Rohan, vicomte de Castelnoec x (1128) Villana de Castille (vers 1085-????) │ ├──> Alain II de Rohan (????-1170), vicomte de Rohan, vicomte de Castelnoec, seigneur de Guéméné et de Guingamp │ x ? │ │ │ ├──> Alain III de Rohan (1135-1195), vicomte de Rohan │ │ x (après 1164) Constance de Penthièvre dite « Constance de Bretagne »[33] (vers 1140 – vers 1184), dame de Richmond, de Corlay et de Mûr-de-Bretagne │ │ │ │ │ ├──> Alain IV de Rohan le Jeune (1166-1205), vicomte de Rohan, seigneur de Guéméné, croisé │ │ │ x Mabile de Fougères[34] (???? – avant 1198) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Geoffroy Ier de Rohan (1190-1221), vicomte de Rohan │ │ │ │ x Marguerite de Thouars-Bretagne │ │ │ │ x (après 04/05/1220) Gervaise de Vitré dite « Gervaise de Dinan »[35] (vers 1185 – vers 1238), vicomtesse de Dinan-sud et de Léhon, dame de Bécherel │ │ │ │ │ │ │ ├──> Conan de Rohan (1190-1221) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Olivier Ier de Rohan (après 1191 – 1228), vicomte de Rohan │ │ │ │ │ │ │ ├──> Alain V de Rohan (avant 1205-1242), vicomte de Rohan │ │ │ │ x Aliénor de Porhoët[36] (vers 1200-????), dame de Lannouée, La Chèze et Loudéac │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Alain VI de Rohan (1232-1304), vicomte de Rohan │ │ │ │ │ x Isabeau de Léon dite « Isabeau de Correc »[37] (????-1266) │ │ │ │ │ x (1266) Thomasse de La Roche-Bernard[38] (vers 1245 – après 1304) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Olivier II de Rohan (1271-1326), vicomte de Rohan │ │ │ │ │ │ x (1307) Alix de Rochefort[39] (vers 1285-????) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Alain VII de Rohan (vers 1308-1352), vicomte de Rohan │ │ │ │ │ │ │ x (1322) Jeanne de Rostrenen[40] (vers 1300-1372), dame de Guéméné-Guégant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Jean Ier de Rohan (1324-1396), vicomte de Rohan, seigneur de Guéméné │ │ │ │ │ │ │ │ x (1349) Jeanne de Léon[41] (????-1372), vicomtesse de Léon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Alain VIII de Rohan (1396-1429), vicomte de Rohan et de Porhoët, seigneur de Blain, de Noyon-sur-Andelle, de Pont-Saint-Pierre et de Radepont │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1407) Béatrix de Clisson[42] (????-1448), vicomtesse de Porhoët, dame de Blain, baronne de Pontchâteau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Alain IX de Rohan (vers 1382-20/03/1462 à La Chèze), vicomte de Rohan, de Léon et de Porhoët, baron de Pontchâteau, seigneur de Blain, de Noyon-sur-Andelle, de Pont-Saint-Pierre, de Radepont et de La Garnache │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (26/06/1407 à Nantes) Marguerite de Montfort dite « Marguerite de Bretagne »[43] (1392-13/04/1428 à Blain), dame de Guillac │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Alain de Rohan (1408-1449 à Fougères), vicomte de Porhoët │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1443) Yolande de Montfort-Laval[44] (01/10/1421 à Nantes – 1487) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marguerite de Rohan (-1496 à Cognac) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (31/08/1449) Jean de Valois-Orléans dit « Jean II de Valois-Angoulême »[45] (1399-1467), comte d'Angoulême et de Périgord, duc de Milan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Gilles de Montmorency-Laval dit « Gilles II de Laval-Loué »[46] (???? – ), vicomte de Brosse, seigneur de Loué, de Benais, de Montsabert, de Marcillé, du Parvis, de Bressuire, de Maillé, La Rochecorborn, de La Haye, et de La Mothe-Saint-Héray │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Jeanne de Rohan (1415 – après 1459) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (11/02/1442) François Ier de Rieux[47] (11/08/1418-20/11/1458), seigneur de Rieux et de Rochefort, baron de Malestroit, comte d'Harcourt, seigneur d'Assérac, vicomte de Donges, conseiller et chambellan de François Ier de Bretagne, chevalier de l'Ordre de l'Hermine, chambellan du dauphin (futur Louis XI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Catherine de Rohan (vers 1425 – après 1471) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (22/04/1429) Jacques de Dinan[48] (????-30/04/1444), chevalier banneret, seigneur de Beaumanoir, de Montafilant, et du Bodister, capitaine de Josselin, gouverneur de Sablé-sur-Sarthe, grand bouteiller de France │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (20/09/1447) Jean Ier d'Albret[49] (1430-03/01/1468), vicomte de Tartas │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Béatrix de Rohan[50] (????-1418) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (16/11/1450) Marie de Lorraine-Vaudémont[51] (????-23/04/1455) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Jean II de Rohan (16/11/1452-01/04/1516 à Blain), vicomte de Rohan et de Léon, comte de Porhoët, seigneur de Blain, de La Garnache et de Beauvoir-sur-Mer, conseiller et chambellan du roi Charles VIII, lieutenant général de Bretagne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1462) Marie de Montfort dite « Marie de Bretagne »[52] (1446-1511) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> François de Rohan (1469-1488 à Saint-Aubin-du-Cormier) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Jean de Rohan (1476-1505) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Jacques Ier de Rohan (1478-23/10/1527 à Corlay), vicomte de Rohan et de Léon, comte de Porhoët │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Françoise, fille de Jean Daillon du Lude │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Françoise de Rohan-Guéméné (voir plus bas) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Georges de Rohan (1479-1502) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Claude de Rohan (1480-08/07/1540), évêque de Quimper et de Cornouaille │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Anne de Rohan (1485-05/04/1529 à Blain), vicomtesse de Rohan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (25/09/1515) Pierre II de Rohan-Gié (????-1525), seigneur de Blain, de Frontenay, de La Marche et de Gié, vicomte de Carentan (voir plus bas) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Marie de Rohan (????-1542) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1511) Louis IV de Rohan-Guéméné (????-1527), seigneur de Guéméné (voir plus bas) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Catherine de Rohan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x René de Keradreux │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1456) Péronnelle de Maillé, baronne douairière de Pontchâteau, fille d'Hardouin VIII de Maillé │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Pierre de Rohan dit « Pierre de Quintin » (1456-24/06/1491), baron de Pontchâteau, seigneur de La Garnache, baron consort de Quintin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (20/11/1484) Jeanne du Perrier (????-1504), baronne de Quintin et de Blossac, dame de La Roche d'Iré │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Christophe de Rohan (???? – avant 1491) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Jeanne de Daillon, fille de Jean Daillon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Isabeau de La Chapelle (????-1519), dame de La Chapelle et de Molac │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis de Rohan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> François de Rohan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Antoine de Rohan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Madeleine de Rohan, nonne à Fontevrault │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Anne de Rohan, nonne à Fontevrault │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Isabeau de Rohan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Jeanne de Rohan, dame de Noyon-sur-Andelle │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (05/04/1374) Robert d'Alençon »[53] (1344-1377), comte du Perche │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Pierre II d'Amboise[54] (vers 1357-1426), vicomte de Thouars │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marguerite de Rohan │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Jean Botterel-Quintin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Édouard de Rohan (???? – vers 1445), vicomte de Léon │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1406) Marguerite de Châteaubriant[55] (????-27/04/1414), dame de Portrie et de La Marousière │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Jeanne de Rohan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Guillaume de Saint-Gilles │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Louise de Rohan, dame de Léon │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Patry III de Châteaugiron (????-27/04/1427 à Pontorson), seigneur de Châteaugiron et de Derval, grand chambellan de Bretagne │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Jean de Rostrenen, seigneur de Coetdor et de La Chesnaye │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Guy de Rohan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1373) Jeanne d'Évreux dite « Jeanne de Navarre »[56] (1339-1409) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Charles de Rohan dit « Charles Ier de Rohan-Guéméné » (1375-1438), seigneur de Guéméné │ │ │ │ │ │ │ │ x (1405) Catherine du Guesclin (????-1461) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Louis Ier de Rohan-Guéméné (????-15/12/1457 à Saint-Quentin-les-Anges), seigneur de Guéméné │ │ │ │ │ │ │ │ x (07/11/1443) Marie de Montauban[57] (????-1497) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis II de Rohan-Guéméné le Grand (vers 1444-25/05/1508), seigneur de Guéméné, baron de Lanvaux, seigneur de La Roche-Moysan, du Mortiercrolles, de Condé-sur-Noireau, de Tracy et de Vassy │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (12/06/1463) Louise de Rieux[58] (01/03/1446 à Ancenis – ????) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Jean de Rohan-Guéméné (vers 1475-1524), seigneur de Landal, gouverneur de Touraine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Guyonne de Lorgeril (????-1502), dame de Lorgeril │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Catherine de Rohan-Guéméné (????-1556), dame de La Ribaudière │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Tanneguy de Kermaven │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Gilbert de Limoges │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marguerite de Rohan-Guéméné (????-1550), dame de Tressant et de La Tourniolle │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Louis de Malestroit, seigneur de Pontcallec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Hélène de Rohan-Guéméné (????-1541), dame de Landal et de Lorgeril │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x François de Maure[59] (1497-1556), comte de Maure │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Isabeau de La Chapelle (????-1519), dame de La Chapelle et de Molac │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marguerite de Rohan-Guéméné (vers 1479-????) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1490) François de Maillé[60] (vers 1465 – ), vicomte de Tours, baron de Maillé │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis III de Rohan-Guéméné (????-1498), seigneur de Guéméné │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1482) Renée du Fou │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis IV de Rohan-Guéméné (????-1527), seigneur de Guéméné │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1511) Marie de Rohan (????-1542) (fille de Jean II de Rohan, voir plus haut) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Louis V de Rohan-Guéméné (1513-1557), seigneur de Guéméné │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1529) Marguerite de Montfort-Laval[61] (1523-????), dame de Perrier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis VI de Rohan-Guéméné (03/04/1540-04/06/1611), prince de Guéméné, comte de Montbazon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (22/07/1561) Léonore de Rohan-Gié (1539-1583), comtesse de Rochefort (voir plus bas) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Renée de Rohan-Guéméné (1558-????) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1578) Jean de Coëtquen (????-1602), comte de Combourg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Lucrèce de Rohan-Guéméné (1560-????) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1574) Jacques de Tournemine (????-1584 à Rennes), marquis de Coetmeur, seigneur de Landinière et de Carmelin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Isabelle de Rohan-Guéméné (1561-????) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1593) Nicolas de Pellevé, comte de Flers │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Pierre de Rohan-Guéméné (1567-1622), prince de Guéméné, duc de Montbazon, baron de Mortiercrolles, seigneur de Sainte-Maure │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Madeleine de Rieux[62] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Anne de Rohan-Guéméné (20/04/1606 à Saint-Quentin-les-Anges – 13/03/1685 à Rochefort-en-Yvelines), princesse de Guéméné │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (02/021619) Louis VIII de Rohan-Guéméné (05/08/1598-28/02/1667 à Coupvray), comte de Rochefort, duc de Montbazon, prince de Guéméné, grand veneur de France, conseiller d'État, gouverneur de Dourdan (voir plus bas) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Antoinette d'Avaugour[63] (????-1681), vicomtesse de Guignen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Hercule Ier de Rohan-Guéméné (27/08/1568-16/10/1654 à Couziers), prince de Guéméné, duc de Montbazon, comte de Rochefort-en-Yvelines, prince de Léon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1594) Madeleine de Lenoncourt[64] (1576-28/08/1602) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis VIII de Rohan-Guéméné (05/08/1598-28/02/1667 à Coupvray), comte de Rochefort, duc de Montbazon, prince de Guéméné, grand veneur de France, conseiller d'État, gouverneur de Dourdan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (02/021619) Anne de Rohan-Guéméné (20/04/1606 à Saint-Quentin-les-Anges – 13/03/1685 à Rochefort-en-Yvelines), princesse de Guéméné (voir plus haut) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis de Rohan-Guéméné dit « le Chevalier de Rohan » (1635-27/11/1674 à Paris), aventurier, Grand veneur de France, colonel des gardes de Louis XIV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Charles II de Rohan-Guéméné (1633-1699), duc de Montbazon, prince de Guéméné │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1653) Jeanne Armande de Schomberg[65] (1632-1706) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charles III de Rohan-Guéméné (30/09/1655-10/10/1727), duc de Montbazon, prince de Guéméné, pair de France │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (19/02/1678) Marie Anne d'Albert[66] (????-1679) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (30/10/1679) Charlotte Élisabeth de Cochefilet dite « Mademoiselle de Vauvineux »[67] (1657-1719) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charlotte de Rohan-Guéméné (30/12/1680-20/09/1733) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1717) Antoine François Gaspard de Colins (????-1720), comte de Mortagne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1729) Jean Antoine de Créquy[68] (09/11/1699-15/12/1762 à Frohen-le-Grand), comte de Canaples │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis Henri de Rohan-Guéméné (-22/01/1689) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> François-Armand de Rohan-Guéméné (1682-1717), duc de Montbazon, prince de Guéméné, brigadier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1698) Louise Julie de La Tour d'Auvergne-Bouillon[69] (1679-1750) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Charles Jules de Rohan-Guéméné (1700-1703) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Anne Thérèse de Rohan-Guéméné (1684-1738), abbesse de l'abbaye Notre-Dame-de-Jouarre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis Henri de Rohan-Guéméné (1686-1748), comte de Rochefort-en-Yvelines │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> ? de Rohan-Guéméné dite « Mademoiselle de Rochefort » (19/11/1687-????) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Hercule II Mériadec de Rohan-Guéméné (13/11/1688-21/12/1757 à Sainte-Maure), duc de Montbazon, prince de Guéméné, pair de France │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1718) Louise Gabrielle Julie de Rohan-Soubise (1704-1741) (voir plus bas) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charlotte Louise de Rohan-Guéméné dite « Mademoiselle de Rohan » (1722-1786) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1737) Vittorio Amedeo Ferrero Fieschi (????-1777), prince de Masserano │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Geneviève Armande de Rohan-Guéméné (1724-1753), abbesse de Marquette │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Jules Hercule Mériadec de Rohan-Guéméné (25/03/1726 à Paris – 10/12/1788 à Carlsbourg), duc de Montbazon, prince de Guéméné │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1743) Marie-Louise Henriette de La Tour d'Auvergne[70] (15/08/1725 à Paris – 1793 à Paris), princesse de Guéméné │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Henri Louis Marie de Rohan-Guéméné (30/08/1745 à Paris – 24/04/1809 à Prague), prince de Rohan-Guéméné, duc de Montbazon, seigneur de Clisson │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (15/01/1761) Victoire Armande Josèphe de Rohan-Soubise dite « Madame de Guéméné » (28/12/1743-20/09/1807 à Paris), princesse de Maubuisson, dame de Clisson (voir plus bas) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charlotte Victoire Josèphe Henriette de Rohan-Guéméné (1761-1771) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charles IV Alain Gabriel de Rohan-Guéméné (18/01/1764 à Versailles – 24/04/1836 à Liberec), duc de Montbazon, prince de Guéméné, duc de Bouillon, seigneur de Clisson │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (29/05/1781 à Paris) Louise Aglaé de Conflans d'Armentières (1763-1819) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Berthe de Rohan-Guéméné (04/05/1782-22/02/1841) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1800) Louis IX Victor Mériadec de Rohan-Guéméné (1766 à Paris – 1846 à Liberec), prince de Guéméné, duc de Bouillon (voir plus bas) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marie Louise Joséphine de Rohan-Guéméné (1765 à Paris – 1839) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1780) Charles Louis Gaspard de Rohan-Rochefort (1765-1843), prince de Montauban (voir plus bas) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis IX Victor Mériadec de Rohan-Guéméné (1766 à Paris – 1846 à Liberec), prince de Guéméné, duc de Bouillon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1800) Berthe de Rohan-Guéméné (04/05/1782-22/02/1841) (voir plus haut) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Jules Armand Louis de Rohan-Guéméné (1768 à Versailles – 1836 à Liberec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1800) Wilhelmine Biron de Kurland (1781-1839) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marie Louise de Rohan-Guéméné (1728-1737) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis-Armand Constantin de Rohan-Guéméné dit « le Chevalier de Rohan » (06/04/1732 à Paris – 27/07/1794 à Paris) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1771) Louise Rosalie Le Tonnelier de Breteuil[71] (????-1792) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis René Édouard de Rohan-Guéméné (25/09/1734 à Paris – 17/02/1803 à Ettenheim), prince de Rohan, cardinal-archevêque de Strasbourg, membre de l'Académie française, Grand aumônier du roi et proviseur de la Sorbonne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Ferdinand Maximilien Mériadec de Rohan-Guéméné (07/11/1738-31/10/1813 à Paris), prince de Rohan-Guéméné, archevêque de Bordeaux, prince-archevêque de Cambrai et de Liège, premier aumônier de l'impératrice Joséphine de Beauharnais │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (relation illégitime) Charlotte Stuart[72] (29/10/1753-17/11/1789) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marie Victoire de Rohan (1779-1836) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Aglaé Clémentine de Rohan (1781-1825) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marie Béatrice de Rohan (1783-1823) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Charles Édouard de Rohan dit « le Chevalier de Roehanstart » (1784-28/10/1854 à Perthshire) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marie Anne de Rohan-Guéméné (1690-1743), abbesse de Penthemont │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Anne de Rohan-Guéméné (1690-1711), religieuse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Élisabeth de Rohan-Guéméné (1691-1753), abbesse de Preaux et de l'abbaye du repos de Notre-Dame de Marquette │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charles de Rohan-Guéméné (1693-1766), dit Charles de Rohan-Rochefort, prince de Rochefort │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1722) Éléonore Eugénie de Béthisy de Mézières (1706-1757), fille d'Eugène │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Branche de Rohan-Rochefort │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Armand de Rohan-Guéméné (10/02/1695 à Paris – 28/08/1762 à Saverne), abbé du Gard et de Gorze, archevêque-duc de Reims, pair de France │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charlotte Julie de Rohan-Guéméné (1696-1756), religieuse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Louis de Rohan-Guéméné dit « le Cardinal de Rohan » (24/03/1697 à Paris – 11/03/1779 à Paris), évêque de Strasbourg, cardinal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Jean-Baptiste de Rohan-Guéméné (1657-1704) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1682) Charlotte de Bautru-Nogent (1641-1725) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Marie Jeanne de Rohan-Guéméné (1683-1710) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Joseph de Rohan-Guéméné (1659-1669) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charlotte de Rohan-Guéméné (1661-1754) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x () Guy-Henri Chabot (27/11/1648-06/11/1690), comte de Jarnac, marquis de Soubran, seigneur de Clion-Somsac, de Maroüette et de Grésignac │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1691) Pons de Pons (????-1705), comte de Roquefort │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Élisabeth de Rohan-Guéméné (1663-1707) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1690) Alexandre de Melun, comte de Melun, petit-fils de Guillaume III de Melun, prince d'Epinoy │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Jeanne de Rohan-Guéméné (????-1728) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marie de Rohan-Guéméné ( à Coupvray – 12/08/1679), duchesse de Luynes et de Chevreuse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (13/09/1617) Charles d'Albert[73] (05/08/1578 à Pont-Saint-Esprit – 15/12/1621 à Longueville), marquis d'Albert, duc de Luynes, connétable de France, pair de France │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (19/04/1622) Claude de Lorraine dit « Claude de Guise »[74] (05/06/1578-24/01/1657), duc de Chevreuse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (05/03/1628) Marie d'Avaugour[75] (1612-28/04/1657 à Paris) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> François de Rohan-Guéméné dit « François de Rohan-Soubise » (1630-24/08/1712 à Paris), prince de Soubise, comte de Rochefort │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (17/04/1663) Anne de Rohan-Chabot (1648-04/02/1709 à Paris), princesse de Soubise │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Branche de Rohan-Soubise │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Anne de Rohan-Guéméné (1640-1684) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1661) Louis Charles d'Albert de Luynes[76] (1620-1690), duc de Luynes, duc de Chevreuse, prince de Léon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Marie Éléonore de Rohan-Guéméné (????-08/04/1682), abbesse de La Trinité de Caen, abbesse de Malnoue │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Sylvie de Rohan-Guéméné (1570-1651) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1594) François d'Espinay (????-1598), marquis de Broons │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1602) Antoine de Sillans (????-1641), baron de Creully │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marguerite de Rohan-Guéméné (1574-1618) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1605) Charles d'Espinay[77] (????-29/01/1607), marquis d'Espinay │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1612) Léonard Philibert de Pompadour (????-1634), vicomte de Pompadour │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Alexandre de Rohan-Guéméné (1578-1638) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1624) Lucette Tarneau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis VII de Rohan-Guéméné (1562-01/11/1589), comte puis duc de Montbazon, comte de Rochefort, prince de Guéméné │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1581) Madeleine de Lenoncourt[64] (1576-28/08/1602) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1586) Françoise de Montmorency-Laval[78] (????-1614) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Renée de Rohan-Guéméné │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x François de Rohan-Gié (1515-1559), seigneur de Gié et de Verger, vicomte de Fronsac, comte d'Orbec (voir plus bas) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1559) René de Montmorency-Laval dit « René II de Laval-Loué »[79] (03/02/1546-08/10/1562), seigneur puis baron de Maillé, seigneur de Loué, de Benais, de Montsabert, de Marcillé, du Parvis, La Rochecorborn, La Haye et des Écluses │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1563) Jean de Montmorency-Laval[79] (25/04/1542-20/09/1578), comte puis marquis de Nesle, comte de Joigny, vicomte de Brosse, seigneur puis baron de Bressuire, seigneur puis baron de La Mothe-Saint-Héray, baron de La Roche-Chabot et de L'Isle-sous-Montréal, marquis de Nesle, baron puis comte de Maillé, seigneur de Loué │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Françoise de Rohan-Guéméné │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Jacques Ier de Rohan (1478-23/10/1527 à Corlay), vicomte de Rohan et de Léon, comte de Porhoët (voir plus haut) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Jeanne de Rohan-Guéméné │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1498) François de Chastellier, vicomte de Pommerit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Catherine de Rohan-Guéméné │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Jean de Malestroit, seigneur de Kerser │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Françoise de Rohan-Guéméné, dame de Marcheville et de Varennes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Louis de Husson, comte de Tonnerre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x François de Maillé[60] (vers 1465 – ), vicomte de Tours, baron de Maillé │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Henri de Rohan-Guéméné, seigneur de Landal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1497) Marguerite du Pont-l'Abbé, dame de Plusquellec, de Callac, de Trogoff et de Coëtanfao │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Jacques de Rohan-Guéméné │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Pierre de Rohan-Guéméné dit « Pierre Ier de Rohan-Gié le Maréchal de Gié » (1451 à Saint-Quentin-les-Anges – 22/04/1513 à Paris), seigneur de Gié, vicomte de Fronsac, maréchal de France │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1476) Françoise de Penhoët (1455-1498), vicomtesse de Fronsac │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Branche de Rohan-Gié │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Maison de Rohan-Chabot │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1503) Marguerite d'Armagnac (????-1503), comtesse de Guise, fille de Jacques d'Armagnac-Nemours" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Hélène de Rohan-Guéméné (????-1507) │ │ │ │ │ │ │ │ x Pierre du Pont (????-1488), baron du Pont │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marguerite de Rohan (vers 1335-14/12/1406) │ │ │ │ │ │ │ │ x (1356) Jean IV de Beaumanoir (1310-1366), seigneur de Beaumanoir, de Merdrignac et de La Hardouinaye, capitaine du château de Josselin, maréchal de Bretagne │ │ │ │ │ │ │ │ x (vers 1378) Olivier V de Clisson[80] (23/04/1336 à Clisson – 23/04/1407 à Josselin), seigneur de Clisson, vicomte de Porhoët, seigneur de Blain, de Josselin, de Belleville, de Montaigu, de La Garnache, de Yerrick et de Beauvoir, baron de Pontchâteau, connétable de France │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Pierre de Rohan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Geoffroy II de Rohan (???? – vers 1377), évêque de Saint-Brieuc et de Vannes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1322) Jeanne de Léon[81] (vers 1307 – avant 1340), dame de Châteauneuf-en-Thymerais │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Josselin de Rohan (????-21/03/1388 à Saint-Malo), évêque de Saint-Malo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Olivier de Rohan (????-20/06/1347) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Thibaut de Rohan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Jeanne de Rohan (vers 1280-????) │ │ │ │ │ │ x (1310) Pierre de Kergolay[82] (????-1336) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Béatrix de Rohan │ │ │ │ │ │ x Jean de Beaumanoir, seigneur de Merdrignac │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Jacques de Rohan │ │ │ │ │ │ x (vers 1316) Peronne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Eudon de Rohan dit « Eudon de Rohan-Gué-de-l'Isle » (???? – après 1346), seigneur du Gué-de-l'Isle │ │ │ │ │ │ x Aliette de Coëtlogon, dame du Gué-de-l'Isle │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Branche de Rohan-Gué-de-l'Isle │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Branche de Rohan-Polduc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Alain de Rohan (????-1299) │ │ │ │ │ │ x Agnès d'Avaugour │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Geoffroy de Rohan (????-1299), chanoine │ │ │ │ │ │ x Catherine de Clisson │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Josselin de Rohan (????-1306) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Guiart de Rohan │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Jeanne de Rohan (1235-????) │ │ │ │ │ x Hervé IV de Léonseigneur de Léon (1225-1281), vicomte de Léon, seigneur de Châteauneuf-en-Thymerais │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Mabile de Rohan │ │ │ │ │ x (1251) Robert de Beaumetz, sire de Beaumetz │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Vilaine de Rohan │ │ │ │ │ x Richard de La Roche-Jagu, seigneur de La Roche-Jagu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Tiphaine de Rohan │ │ │ │ │ x Geoffroy II de Lanvaux, seigneur de Lanvaux │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Philippa de Rohan │ │ │ │ │ x Henri d'Avaugour, seigneur de Goëlo │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Geoffroy de Rohan, seigneur de Noial │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Mériadec de Rohan (????-1301), évêque de Vannes │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Philippe de Rohan │ │ │ │ │ │ │ ├──> Catherine de Rohan │ │ │ │ x Geoffroy de Hennebont, seigneur d'Hennebont │ │ │ │ x Raoul Niel, seigneur de La Muce │ │ │ │ │ │ │ └──> Héloïse de Rohan │ │ │ ├──> Constance de Rohan (vers 1170-????) │ │ x Eudon du Pont dit « Eudes Ier de Pontchâteau »[83] (vers 1165 – après 1200), baron de Pontchâteau │ │ │ │ │ ├──> Guillaume de Rohan (????-1184) │ │ │ ├──> Marguerite de Rohan │ x (1180) Hervé Ier de Léon[84] (vers 1165-1208) │ │ │ ├──> Alix de Rohan │ │ │ x Françoise de Corbey │ │ │ └──> Josselin de Rohan (????-1251), seigneur de Montfort(-sur-Meu) et de Noial, vicomte de Rohan, seigneur de Montauban │ x (avant 1252) Mahaut de Montfort[85] (vers 1214-1279), dame de Montfort(-sur-Meu) et de Boutavant │ └──> branche de Rohan-Montauban │ ├──> Josselin de Rohan (????-1127) │ └──> Eudon de Rohan
Pour le détail des branches de l'arbre, voir ci-après.
Remove ads
Les différentes branches de la maison de Rohan
Résumé
Contexte
Branche de Rohan-Guémené
- Église Notre-Dame de Larmor-Plage : le retable de la Vierge à l'Enfant. On distingue les blasons de Louis II de Rohan-Guéméné (1444-1508) et de son épouse Louise de Rieux (née le ).

Branche issue vers 1375 de Jean Ier de Rohan (1324-1396), vicomte de Rohan, et de sa seconde épouse Jeanne de Navarre (1339-1403).
Elle doit son nom à la ville de Guémené-sur-Scorff (Morbihan).
Cette branche de Rohan-Guémené a fait en 1782 une banqueroute de 33 millions de livres en la personne d'Henri-Louis-Marie de Rohan et de son épouse, Victoire de Rohan. Elle subsiste aujourd'hui dans son rameau de Rohan-Rochefort.
Branche des Rohan-Guémené
… │ └──> Jean Ier de Rohan (1324-1396), vicomte de Rohan, seigneur de Guémené x (1373) Jeanne de Navarre »[56] (1339-1409) │ └──> Charles de Rohan dit « Charles Ier de Rohan-Guémené » (1375-1438), seigneur de Guémené x (1405) Catherine du Guesclin (????-1461) │ └──> Louis Ier de Rohan-Guémené (????-15/12/1457 à Saint-Quentin-les-Anges), seigneur de Guémené x (07/11/1443) Marie de Montauban[57] (????-1497) │ ├──> Louis II de Rohan-Guémené le Grand (vers 1444-25/05/1508), seigneur de Guémené, baron de Lanvaux, seigneur de La Roche-Moysan, du Mortiercrolles, de Condé-sur-Noireau, de Tracy et de Vassy │ x (12/06/1463) Louise de Rieux[58] (01/03/1446 à Ancenis – ????) │ │ │ ├──> Jean de Rohan-Guémené (vers 1475-1524), seigneur de Landal, gouverneur de Touraine │ │ x Guyonne de Lorgeril (????-1502), dame de Lorgeril │ │ │ │ │ ├──> Catherine de Rohan-Guémené (????-1556), dame de La Ribaudière │ │ │ x Tanneguy de Kermaven │ │ │ x Gilbert de Limoges │ │ │ │ │ ├──> Marguerite de Rohan-Guémené (????-1550), dame de Tressant et de La Tourniolle │ │ │ x Louis de Malestroit, seigneur de Pontcallec │ │ │ │ │ ├──> Hélène de Rohan-Guémené (????-1541), dame de Landal et de Lorgeril │ │ │ x François de Maure[59] (1497-1556), comte de Maure │ │ │ │ │ x Isabeau de La Chapelle (????-1519), dame de La Chapelle et de Molac │ │ │ ├──> Marguerite de Rohan-Guémené (vers 1479-????) │ │ x (1490) François de Maillé[60] (vers 1465 – ), vicomte de Tours, baron de Maillé │ │ │ ├──> Louis III de Rohan-Guémené (????-1498), seigneur de Guémené │ │ x (1482) Renée de Fou │ │ │ │ │ ├──> Louis IV de Rohan-Guémené (????-1527), seigneur de Guémené │ │ │ x (1511) Marie de Rohan (????-1542) (fille de Jean II de Rohan, voir plus haut) │ │ │ │ │ │ │ └──> Louis V de Rohan-Guémené (1513-1557), seigneur de Guémené │ │ │ x (1529) Marguerite de Montfort-Laval[61] (1523-????), dame de Perrier │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis VI de Rohan-Guémené (03/04/1540-04/06/1611), prince de Guémené, comte de Montbazon │ │ │ │ x (22/07/1561) Léonore de Rohan-Gié (1539-1583), comtesse de Rochefort (voir plus bas) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Renée de Rohan-Guémené (1558-????) │ │ │ │ │ x (1578) Jean de Coëtquen (????-1602), comte de Combourg │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Lucrèce de Rohan-Guéméné (1560-????) │ │ │ │ │ x (1574) Jacques de Tournemine (????-1584 à Rennes), marquis de Coetmeur, seigneur de Landinière et de Carmelin │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Isabelle de Rohan-Guémené (1561-????) │ │ │ │ │ x (1593) Nicolas de Pellevé, comte de Flers │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Pierre de Rohan-Guémené (1567-1622), prince de Guémené, duc de Montbazon, baron de Mortiercrolles, seigneur de Sainte-Maure │ │ │ │ │ x Madeleine de Rieux[62] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Anne de Rohan-Guémené (20/04/1606 à Saint-Quentin-les-Anges – 13/03/1685 à Rochefort-en-Yvelines), princesse de Guémené │ │ │ │ │ │ x (02/021619) Louis VIII de Rohan-Guémené (05/08/1598-28/02/1667 à Coupvray), comte de Rochefort, duc de Montbazon, prince de Guémené, grand veneur de France, conseiller d'État, gouverneur de Dourdan (voir plus bas) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Antoinette d'Avaugour[63] (????-1681), vicomtesse de Guiguen │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Hercule Ier de Rohan-Guémené (27/08/1568-16/10/1654 à Couziers), prince de Guémené, duc de Montbazon, comte de Rochefort-en-Yvelines, prince de Léon │ │ │ │ │ x (1594) Madeleine de Lenoncourt[64] (1576-28/08/1602) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis VIII de Rohan-Guémené (05/08/1598-28/02/1667 à Coupvray), comte de Rochefort-en-Yvelines, duc de Montbazon, prince de Guémené, grand veneur de France, conseiller d'État, gouverneur de Dourdan │ │ │ │ │ │ x (02/021619) Anne de Rohan-Guémené (20/04/1606 à Saint-Quentin-les-Anges – 13/03/1685 à Rochefort-en-Yvelines), princesse de Guéméné (voir plus haut) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis de Rohan-Guémené dit « le Chevalier de Rohan » (1635-27/11/1674 à Paris), aventurier, Grand veneur de France, colonel des gardes de Louis XIV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Charles II de Rohan-Guémené (1633-1699), duc de Montbazon, prince de Guémené │ │ │ │ │ │ x (1653) Jeanne Armande de Schomberg[65] (1632-1706) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charles III de Rohan-Guémené (30/09/1655-10/10/1727), duc de Montbazon, prince de Guémené, pair de France │ │ │ │ │ │ │ x (19/02/1678) Marie Anne d'Albert[66] (????-1679) │ │ │ │ │ │ │ x (30/10/1679) Charlotte Élisabeth de Cochefilet dite « Mademoiselle de Vauvineux »[67] (1657-1719) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charlotte de Rohan-Guémené (30/12/1680-20/09/1733) │ │ │ │ │ │ │ │ x (1717) Antoine François Gaspard de Colins (????-1720), comte de Mortagne │ │ │ │ │ │ │ │ x (1729) Jean Antoine de Créquy[68] (09/11/1699-15/12/1762 à Frohen-le-Grand), comte de Canaples │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis Henri de Rohan-Guémené (-22/01/1689) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> François-Armand de Rohan-Guéméné (1682-1717), duc de Montbazon, prince de Guéméné, brigadier │ │ │ │ │ │ │ │ x (1698) Louise Julie de La Tour d'Auvergne-Bouillon[69] (1679-1750) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Charles Jules de Rohan-Guémené (1700-1703) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Anne Thérèse de Rohan-Guémené (1684-1738), abbesse de l'Abbaye Notre-Dame de Jouarre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis Henri de Rohan-Guémené (1686-1748), comte de Rochefort-en-Yvelines │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> ? de Rohan-Guémené dite « Mademoiselle de Rochefort » (19/11/1687-????) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Hercule II Mériadec de Rohan-Guémené (13/11/1688-21/12/1757 à Sainte-Maure), duc de Montbazon, prince de Guémené, pair de France │ │ │ │ │ │ │ │ x (1718) Louise Gabrielle Julie de Rohan-Soubise (1704-1741) (voir plus bas) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charlotte Louise de Rohan-Guémené dite « Mademoiselle de Rohan » (1722-1786) │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1737) Vittorio Amedeo Ferrero Fieschi (????-1777), prince de Masserano │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Geneviève de Rohan-Guémené (1724-1753), abbesse de Marquette │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Jules de Rohan-Guémené (25/03/1726 à Paris – 10/12/1788 à Carlsbourg), duc de Montbazon, prince de Guémené │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1743) Marie-Louise Henriette de La Tour d'Auvergne[70] (15/08/1725 à Paris – 1793 à Paris), princesse de Guémené │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Henri de Rohan-Guémené (30/08/1745 à Paris – 24/04/1809 à Prague), prince de Rohan-Guémené, duc de Montbazon, seigneur de Clisson │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (15/01/1761) Victoire de Rohan-Soubise dite « Madame de Guémené » (28/12/1743-20/09/1807 à Paris), princesse de Maubuisson, dame de Clisson (voir plus bas) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charlotte de Rohan-Guémené (1761-1771) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charles IV de Rohan-Guémené (18/01/1764 à Versailles – 24/04/1836 à Liberec), duc de Montbazon, prince de Guémené, duc de Bouillon, seigneur de Clisson │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (29/05/1781 à Paris) Louise Aglaé de Conflans d'Armentières (1763-1819) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Berthe de Rohan-Guémené (04/05/1782-22/02/1841) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1800) Louis IX Victor Mériadec de Rohan-Guémené (1766 à Paris – 1846 à Liberec), prince de Guémené, duc de Bouillon (voir plus bas) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marie de Rohan-Guémené (1765 à Paris – 1839) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1780) Charles de Rohan-Rochefort (1765-1843), prince de Montaubon (voir plus bas) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis IX de Rohan-Guémené (1766 à Paris – 1846 à Liberec), prince de Guémené, duc de Bouillon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1800) Berthe de Rohan-Guémené (04/05/1782-22/02/1841) (voir plus haut) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Jules de Rohan-Guémené (1768 à Versailles – 1836 à Liberec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1800) Wilhelmine Biron de Kurland (1781-1839) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marie Louise de Rohan-Guémené (1728-1737) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis-Armand de Rohan-Guémené dit « le Chevalier de Rohan » (06/04/1732 à Paris – 27/07/1794 à Paris) │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1771) Louise Le Tonnelier de Breteuil[71] (????-1792) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis de Rohan-Guémené (25/09/1734 à Paris – 17/02/1803 à Ettenheim), prince de Rohan, cardinal-archevêque de Strasbourg, membre de l'Académie française, grand aumônier du roi et proviseur de la Sorbonne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Ferdinand de Rohan-Guémené (07/11/1738-31/10/1813 à Paris), prince de Rohan-Guémené, archevêque de Bordeaux, prince-archevêque de Cambrai et de Liège, premier aumônier de l'impératrice Joséphine de Beauharnais │ │ │ │ │ │ │ │ x (relation illégitime) Charlotte Stuart[72] (29/10/1753-17/11/1789) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marie Victoire de Rohan (1779-1836) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Aglaé Clémentine de Rohan (1781-1825) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marie Béatrice de Rohan (1783-1823) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Charles Édouard de Rohan dit « le Chevalier de Roehanstart » (1784-28/10/1854 à Perthshire) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marie Anne de Rohan-Guémené (1690-1743), abbesse de Penthemont │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Anne de Rohan-Guémené (1690-1711), religieuse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Élisabeth de Rohan-Guémené (1691-1753), abbesse de Preaux et de l'abbaye du repos de Notre-Dame de Marquette │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charles de Rohan-Guémené dit « Charles de Rohan-Rochefort » (1693-1766), prince de Rochefort │ │ │ │ │ │ │ │ x (1722) Éléonore Eugénie de Béthisy de Mézières (1706-1757) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> branche de Rohan-Rochefort │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Armand de Rohan-Guémené (10/02/1695 à Paris – 28/08/1762 à Saverne), abbé du Gard et de Gorze, archevêque-duc de Reims, pair de France │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charlotte de Rohan-Guémené (1696-1756), religieuse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Louis de Rohan-Guémené dit « le Cardinal de Rohan » (24/03/1697 à Paris – 11/03/1779 à Paris), évêque de Strasbourg, cardinal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Jean-Baptiste de Rohan-Guémené (1657-1704) │ │ │ │ │ │ │ x (1682) Charlotte de Bautru-Nogent (1641-1725) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Marie Jeanne de Rohan-Guémené (1683-1710) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Joseph de Rohan-Guémené (1659-1669) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charlotte de Rohan-Guémené (1661-1754) │ │ │ │ │ │ │ x () Guy-Henri Chabot (27/11/1648-06/11/1690), comte de Jarnac, marquis de Soubran, seigneur de Clion-Somsac, de Maroüette et de Grésignac │ │ │ │ │ │ │ x (1691) Pons de Pons (????-1705), comte de Roquefort │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Élisabeth de Rohan-Guémené (1663-1707) │ │ │ │ │ │ │ x (1690) Alexandre de Melun, comte de Melun │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Jeanne de Rohan-Guémené (????-1728) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marie de Rohan-Guémené ( à Coupvray – 12/08/1679), duchesse de Luynes et de Chevreuse │ │ │ │ │ │ x (13/09/1617) Charles d'Albert[73] (05/08/1578 à Pont-Saint-Esprit – 15/12/1621 à Longueville), marquis d'Albert, duc de Luynes, connétable de France, pair de France │ │ │ │ │ │ x (19/04/1622) Claude de Lorraine dit « Claude de Guise »[74] (05/06/1578-24/01/1657), duc de Chevreuse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (05/03/1628) Marie d'Avaugour[75] (1612-28/04/1657 à Paris) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> François de Rohan-Guémené dit « François de Rohan-Soubise » (1630-24/08/1712 à Paris), prince de Soubise, comte de Rochefort │ │ │ │ │ │ x (17/04/1663) Anne Julie de Rohan-Chabot (1648-04/02/1709 à Paris), princesse de Soubise │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> branche de Rohan-Soubise │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Catherine de Lyonne (????-1660) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Anne de Rohan-Guémené (1640-1684) │ │ │ │ │ │ x (1661) Louis d'Albert de Luynes[76] (1620-1690), duc de Luynes, duc de Chevreuse, prince de Léon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Marie Éléonore de Rohan-Guémené (????-08/04/1682), abbesse de La Trinité de Caen, abbesse de Malnoue │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Sylvie de Rohan-Guémené (1570-1651) │ │ │ │ │ x (1594) François d'Espinay (????-1598), marquis de Broons │ │ │ │ │ x (1602) Antoine de Sillans (????-1641), baron de Creuilly │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marguerite de Rohan-Guémené (1574-1618) │ │ │ │ │ x (1605) Charles d'Espinay[77] (????-29/01/1607), marquis d'Espinay │ │ │ │ │ x (1612) Léonard Philibert de Pompadour (????-1634), vicomte de Pompadour │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Alexandre de Rohan-Guémené (1578-1638) │ │ │ │ │ x (1624) Lucette Tarneau │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis VII de Rohan-Guémené (1562-01/11/1589), comte puis duc de Montbazon, comte de Rochefort, prince de Guémené │ │ │ │ │ x (1581) Madeleine de Lenoncourt[64] (1576-28/08/1602) │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (1586) Françoise de Montmorency-Laval[78] (????-1614) │ │ │ │ │ │ │ └──> Renée de Rohan-Guémené │ │ │ x François de Rohan-Gié (1515-1559), seigneur de Gié et de Verger, vicomte de Fronsac, comte d'Orbec (voir plus bas) │ │ │ x (1559) René de Montmorency-Laval dit « René II de Laval-Loué »[79] (03/02/1546-08/10/1562), seigneur puis baron de Maillé, seigneur de Loué, de Benais, de Montsabert, de Marcillé, du Parvis, La Rochecorborn, La Haye et des Écluses │ │ │ x (1563) Jean de Montmorency-Laval[79] (25/04/1542-20/09/1578), comte puis marquis de Nesle, comte de Joigny, vicomte de Brosse, seigneur puis baron de Bressuire, seigneur puis baron de La Motte-Sainte-Heraye, baron de La Roche-Chabot et de L'Isle-sous-Montréal, marquis de Nesle, baron puis comte de Maillé, seigneur de Loué │ │ │ │ │ └──> Françoise de Rohan-Guémené │ │ x Jacques Ier de Rohan (1478-23/10/1527 à Corlay), vicomte de Rohan et de Léon, comte de Porhoët (voir plus haut) │ │ │ ├──> Jeanne de Rohan-Guémené │ │ x (1498) François de Chastellier, vicomte de Pommerit │ │ │ ├──> Catherine de Rohan-Guémené │ │ x Jean de Malestroit, seigneur de Kerser │ │ │ ├──> Françoise de Rohan-Guémené, dame de Marcheville et de Varennes │ │ x Louis de Husson, comte de Tonnerre │ │ x François de Maillé[60] (vers 1465 – ), vicomte de Tours, baron de Maillé │ │ │ ├──> Henri de Rohan-Guémené, seigneur de Landal │ │ x (1497) Marguerite du Pont-l'Abbé, dame de Plusquellec, de Callac, de Trogoff et de Coëtanfao │ │ │ └──> Jacques de Rohan-Guémené │ ├──> Pierre de Rohan-Guémené dit « Pierre Ier de Rohan-Gié, le Maréchal de Gié » (1451 à Saint-Quentin-les-Anges – 22/04/1513 à Paris), seigneur de Gié, vicomte de Fronsac, maréchal de France │ x (1476) Françoise de Penhoët (1455-1498), vicomtesse de Fronsac │ │ │ ├──> Branche de Rohan-Gié │ │ │ │ │ └──> Maison de Rohan-Chabot │ │ │ x (1503) Marguerite d'Armagnac (????-1503), comtesse de Guise, fille de Jacques d'Armagnac-Nemours" │ └──> Hélène de Rohan-Guémené (????-1507) x Pierre du Pont (????-1488), baron du Pont
Branche de Rohan-Rochefort

Rameau issue de la branche des Rohan-Guéméné (avec Charles de Rohan-Guémené dit « Charles de Rohan-Rochefort » (1693-1766) qui prit le titre de prince de Rochefort.
Cette ligne de Rohan-Rochefort fixée en Autriche depuis le début du XIXe siècle, puis aussi en Grande-Bretagne et aux États-Unis, est aujourd'hui la dernière branche subsistante de la maison de Rohan.
Elle réunit les titres authentiques de duc de Montbazon (France 1588), duc de Bouillon (1816) (congrès de Vienne), prince de Rohan et du Saint-Empire avec le prédicat d'altesse sérénissime (Durchlaucht), confirmé en 1808 par lettres de grande naturalisation, par l'empereur François Ier d'Autriche pour tous les membres de la famille.
Le chef de la Maison était membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs d'Autriche.
Branche des Rohan-Rochefort
… │ └──> Charles III de Rohan-Guéméné (30/09/1655-10/10/1727), duc de Montbazon, prince de Guémené, pair de France x (30/10/1679) Charlotte Élisabeth de Cochefilet (1657-1719), dite « Mademoiselle de Vauvineux », fille de Charles de Cochefilet, comte de Vauvineux │ └──> Charles de Rohan-Guéméné dit « Charles de Rohan-Rochefort » (1693-1766), prince de Rochefort et prince de Montauban x (1722) Éléonore Eugénie de Béthisy de Mézières (1706-1757) │ ├──> Éléonore de Rohan-Rochefort (1728-1792) │ x (1742) Jean de Merode (????-1763), comte de Merode │ ├──> Charles-Jules de Rohan-Rochefort (1729-1811) │ x (1762) Marie Henriette d'Orléans-Rothelin (1744-????) │ │ │ ├──> Charles Mériadec de Rohan-Rochefort (1763-1764) │ │ │ ├──> Charles de Rohan-Rochefort (1765-1843), prince de Montauban │ │ x (1780) Marie Louise Joséphine de Rohan-Guéméné (1765 à Paris – 1839) (voir plus haut) │ │ │ │ │ ├──> Hermine de Rohan-Rochefort (1785-1843) │ │ │ x (1809) Gabriel Joseph de Froment (1747-1826), baron de Castille │ │ │ │ │ ├──> Armande Louise de Rohan-Rochefort (1787-1864) │ │ │ x (1806) Alexandre de Pierre de Bernis (1777-1845), marquis de Pierre de Bernis │ │ │ │ │ ├──> Gasparine de Rohan-Rochefort (1798-1871) │ │ │ x (07/01/1822 à Prague) Heinrich XIX Reuss zu Greiz (01/03/1790 à Offenbach-sur-le-Main – 31/10/1836 à Greiz) │ │ │ │ │ ├──> Camille de Rohan-Rochefort (1800-1892), prince de Guémené │ │ │ x (1826) Adelheid von Löwenstein-Wertheim-Rosemberg (1806-1884) │ │ │ │ │ └──> Benjamin de Rohan-Rochefort (1804-1846) │ │ x (1825) Stéphanie de Croÿ (1805-1884) │ │ │ │ │ ├──> Arthur de Rohan-Rochefort (1826-1885) │ │ │ x (1850) Gabrielle von Waldstein-Wartenberg (1827-1890) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Karl de Rohan-Rochefort (1851-1852) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Alain Ier de Rohan-Rochefort (1853-1914), prince de Guémené │ │ │ │ x (1885) Johanna d'Auersperg (1860-1922) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Gabrielle de Rohan-Rochefort (1887-1917) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Berthe de Rohan-Rochefort (1889-1977) │ │ │ │ │ x (1920) Ottokar Picot de Peccaduc (1888-1965), baron de Herzogenburg │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Johanna de Rohan-Rochefort (1890-1961) │ │ │ │ │ x (1922) Rudolf von Colloredo-Mansfeld (????-1948), comte de Colloredo-Mansfeld │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Alain II de Rohan-Rochefort (1893-1976), prince de Guémené │ │ │ │ │ x (1921) Marguerite von Schoenburg-Hartenstein (1897-1980) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marie Jeanne de Rohan-Rochefort (1922) │ │ │ │ │ │ x (1948) Pierre Naquet │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marguerite de Rohan-Rochefort (1923) │ │ │ │ │ │ x (1945) Kunata Kottulinsky, comte Kottulinsky │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Mabile de Rohan-Rochefort (1924-1982) │ │ │ │ │ │ x (1952) Richard de Belcredi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Adélaïde de Rohan-Rochefort (1927-1931) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Gabrielle de Rohan-Rochefort (1929-10/02/1991) │ │ │ │ │ │ x (26/01/1953) Louis Cottafavi (07/03/1917) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Aliette de Rohan-Rochefort (1930-1968) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Josseline de Rohan-Rochefort (1934) │ │ │ │ │ x (1958) Viktor Gottfried Riedl │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marie de Rohan-Rochefort (1893-1966) │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Karl Anton de Rohan-Rochefort (1898-1975) │ │ │ │ x (1933) Marie Apponyi (1899-1967) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charles V de Rohan-Rochefort (1934-2008), prince de Guémené │ │ │ │ │ x (1963) Ingeborg Irnberger (1939) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Charlotte de Rohan-Rochefort (1966) │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Albert de Rohan-Rochefort dit « Albert Rohan » (09/05/1936 à Melk-05/06/2019), prince de Guémené, diplomate autrichien │ │ │ │ x (1985) Elisabeth Burghardt (1948-03/08/1994) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Joseph de Rohan-Rochefort (1854-1926) │ │ │ │ x (1883) Elisabeth Pejacsevich (1860-1884) │ │ │ │ x (1891) Anna Lincke (1857-1925) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Stéphanie de Rohan-Rochefort (1892-1908) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Joséphine de Rohan-Rochefort (1893-????) │ │ │ │ │ x (1922) Friedrich Willner (1887-????) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Joseph de Rohan-Rochefort (1895-1931) │ │ │ │ │ x (1922) Dilkuska Wrench │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marie de Rohan-Rochefort (1900-1907) │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Margaret de Rohan-Rochefort (1905-????) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Victor de Rohan-Rochefort (1856-1882) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Benjamin de Rohan-Rochefort (1858-1889) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Ernest de Rohan-Rochefort (1863-1895) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Édouard de Rohan-Rochefort (1867-1892) │ │ │ │ │ │ │ └──> Marie-Berthe Françoise Félicie Jeanne de Rohan-Rochefort (21/05/1868 à Teplice – 19/01/1945 à Vienne) │ │ │ x (29/04/1894 à Prague) Charles de Bourbon (30/03/1848 à Ljubljana – 18/07/1909 à Varèse), « duc de Madrid », héritier du trône royal de France, fils de Jean de Bourbon (15/05/1822 à Aranjuez – 19/11/1887 à Hove), « comte de Montizon », héritier du trône royal de France │ │ │ │ │ ├──> Victor de Rohan-Rochefort (1827-1889) │ │ │ x (1872) Maria von Degenfeld-Schonburg (1851-1924) │ │ │ │ │ ├──> Alain de Rohan-Rochefort (1829-1857) │ │ │ │ │ ├──> Louis de Rohan-Rochefort (1833-1891) │ │ │ x (1860) Hélène d'Auersperg (1836-1897) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Raoul de Rohan-Rochefort (1860-1931) │ │ │ │ x (1888) Agnès Rock (1865-1926) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marie de Rohan-Rochefort (1891-1977) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Oscar de Rohan-Rochefort (1892-1918) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charles de Rohan-Rochefort (1894-1965) │ │ │ │ │ x (1923) Marie Anna Edle de Hardtmuth (1903-1994) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charles Louis Francis Raoul Oscar Maria de Rohan-Rochefort (05/12/1924-27/02/2005) │ │ │ │ │ │ x (02/09/1949) Nancy Southgate-Jones (11/06/1927-23/06/2018) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Élisabeth Camille Maria Ann de Rohan-Rochefort (1951) │ │ │ │ │ │ │ x (1974) Kurt Valley (1951) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charles Raoul de Rohan-Rochefort (1954) │ │ │ │ │ │ │ x (1985) Patricia Ann Price (1950) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Catherine de Rohan-Rochefort (1989) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Marie Alexandra de Rohan-Rochefort (1992) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Geoffrey Alexander Francis de Rohan-Rochefort (1958) │ │ │ │ │ │ │ x (1981) Hélène Louise du Bosc (1958) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Rembert Charles Francis de Rohan-Rochefort (1986) │ │ │ │ │ │ │ │ x (2022) Anna Macedo (1988) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Hugo de Rohan-Rochefort (2022) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Corinne de Rohan-Rochefort (1989) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x (05/04/1975) Virginia Putnam Durrell (28/01/1938-12/04/2016) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis Francis Raoul Olivier Carl Maria de Rohan-Rochefort (08/06/1927-04/04/1975) │ │ │ │ │ │ x (18/05/1957) Félicité Ortner (11/06/1932-12/2004) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Anne Elizabeth Mary de Rohan-Rochefort (1959) │ │ │ │ │ │ │ x (1983) Hugh Buchanan (1958) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charles Raoul de Rohan-Rochefort (1961) │ │ │ │ │ │ │ x (1989) Sarah Louise Margerrison (1962) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Georgia Louise de Rohan-Rochefort (31/03/1993) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Éléonore Grace de Rohan-Rochefort (03/09/1995) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Louis Albert de Rohan-Rochefort (2001) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Marie Louise de Rohan-Rochefort (08/02/1967) │ │ │ │ │ │ x (11/06/1994) William Robert Shaw (08/09/1964) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Raoul Benjamin Richard Maria Carl Josef Judas Taddäus de Rohan-Rochefort (09/01/1932-29/06/2023) │ │ │ │ │ x (17/11/1962) Anette Morley (05/02/1941) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Nicolas Louis Philippe de Rohan-Rochefort (1966) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Anuschka Lara Marie Thérese de Rohan-Rochefort (1968) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis Charles Dominic de Rohan-Rochefort (1970) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Philippe Francis Raoul de Rohan-Rochefort (1970) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Thérèse de Rohan-Rochefort (1896-1977) │ │ │ │ │ x (1923) Adolf Ritter Weiss de Tessbach (1897-1979) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Raoul de Rohan-Rochefort (1897-1961) │ │ │ │ │ x (1925) Ilona Marie Luzsensky (1906-????) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Béatrix de Rohan-Rochefort (1926) │ │ │ │ │ │ x Vaclav Rysava │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Henry de Rohan-Rochefort (1930-1955) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Marie Antoinette de Rohan-Rochefort │ │ │ │ │ x (1960) Karl Helmer (1935) │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Clotilde de Rohan-Rochefort (1901-1957) │ │ │ │ x (1927) Otto Ritter Weiss de Tessbach (1898-1945) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Josselin de Rohan-Rochefort (1862-1864) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Louis de Rohan-[Rochefort (1865-1887) │ │ │ │ │ │ │ └──> Stéphanie de Rohan-Rochefort (1868-1898) │ │ │ x (1896) Alekséï Troubetzkoï │ │ │ │ │ └──> Benjamin de Rohan-Rochefort (1835-1900) │ │ x (1886) Ameline Julie Marie Mahe de Kerouant (1828-1905) │ │ │ ├──> Charlotte de Rohan-Rochefort (25/10/1767-01/05/1841) │ │ x (18/02/1804 à Baden) Louis de Bourbon (02/08/1772 à Chantilly – 21/03/1804 à Vincennes), duc d'Enghien, fils de Louis VI de Bourbon (13/04/1756 à Chantilly – 27/08/1830), prince de Condé, et de Bathilde d'Orléans (09/07/1750 à Saint-Cloud - 10/01/1822 à Paris) │ │ │ ├──> Louis de Rohan-Rochefort (1770-1794) │ │ │ └──> Clémentine de Rohan-Rochefort (1786-1850) │ x François Louis de Gaudechart (????-1832), marquis de Querrieu │ ├──> Louise de Rohan-Rochefort (1734-1815) │ x (1748) Louis de Lorraine dit « Louis III de Guise » (1725-1761), fils de Louis de Lorraine dit « Louis II de Guise » (1692-1743), prince de Lambesc, comte de Braine, et de Jeanne Marguerite de Durfort (1691-1750) │ └──> Eugène de Rohan-Rochefort (1737-????)
Branche de Rohan-Soubise

Branche issue des Rohan-Guéméné en 1630, les terres de Soubise en Poitou (aujourd'hui Soubise (Charente-Maritime), et le Parc-Soubise, à Mouchamps en Vendée), provenant des Rohan-Chabot par mariage.
Notamment représentée par Charles de Rohan-Soubise dit « le Maréchal de Soubise » (1715-1787), prince de Soubise et maréchal de France, et sa fille Charlotte Godefride Élisabeth de Rohan-Soubise (1737-1760), épouse du prince de Condé Louis V Joseph de Bourbon (1736-1818).
Depuis 1717, le chef de branche porte le titre de duc de Rohan-Rohan. Pour Hercule Mériadec de Rohan-Soubise (1669-1749), la terre de Frontenay-l'Abattu (en Deux-Sèvres, Poitou) est érigée en 1717 en duché-pairie sous le nom de duché de Rohan-Rohan pour se différencier des Rohan-Chabot, ducs de Rohan.
Branche éteinte dans les Rohan-Guéméné en 1807.
Branche des Rohan-Soubise
… │ └──> Hercule Ier de Rohan-Guéméné (27/08/1568-16/10/1654 à Couziers), prince de Guéméné, duc de Montbazon, comte de Rochefort-en-Yvelines, prince de Léon x (05/03/1628) Marie d'Avaugour[75] (1612-28/04/1657 à Paris) │ └──> François de Rohan-Guéméné dit « François de Rohan-Soubise » (1630-24/08/1712 à Paris), prince de Soubise, comte de Rochefort x (17/04/1663) Anne Julie de Rohan-Chabot (1648-04/02/1709 à Paris), princesse de Soubise │ ├──> Anne Marguerite de Rohan-Soubise (05/08/1664-26/06/1721) │ ├──> Louis de Rohan-Soubise (11/03/1666-05/11/1689) │ ├──> Constance Émilie de Rohan-Soubise (1667-????) │ x (1683) José Ier Rodriguez Tellez da Camara (????-1724), comte de Ribeyra-Grande │ ├──> Hercule Mériadec de Rohan-Soubise (08/05/1669-26/01/1749 à Paris), duc de Rohan-Rohan, prince de Soubise et de Maubuisson │ x (15/02/1694) Anne Geneviève de Lévis-Ventadour ( – 20/03/1727 à Paris), fille de Louis Charles de Lévis (1647-28/09/1717 à Paris), duc de Ventadour, et de Charlotte Éléonore Magdeleine de La Mothe-Houdancourt (1654-13/12/1739 à Versailles) │ │ │ ├──> Charlotte de Rohan-Soubise (1696-1733) │ │ │ ├──> Jules François Louis de Rohan-Soubise (16/01/1697 à Paris – 06/05/1724 à Paris), prince de Soubise, capitaine-lieutenant des gendarmes de la garde du roi │ │ x (16/09/1714 à Paris) Anne-Julie Adélaïde de Melun (1698-18/05/1724 à Paris), princesse de Soubise, fille de Louis Ier de Melun (27/10/1673-24/09/1704), prince d'Épinoy, et d'Élisabeth Thérèse de Lorraine (1664-1748), dame de Villemareuil, de Vaucourtois et de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux │ │ │ │ │ ├──> Charles de Rohan-Soubise dit « le Maréchal de Soubise » (16/07/1715 à Versailles – 01/07/1787 à Paris), prince de Soubise et d'Épinoy, duc de Rohan-Rohan, de Ventadour et de Goëlo, comte de Saint-Pol, seigneur de Roberval et de Clisson, ministre des rois Louis XV et Louis XVI, maréchal de France │ │ │ x (28/12/1734) Anne de La Tour d'Auvergne (01/08/1722 à Paris – 19/09/1739 à Paris), fille d'Emmanuel-Théodose de La Tour d'Auvergne, duc de Bouillon (1668 – ), duc de Bouillon, et d'Anne Marie Christiane de Simiane │ │ │ │ │ │ │ ├──> Charlotte de Rohan-Soubise (07/10/1737-04/03/1760), princesse de Condé │ │ │ │ x (03/05/1753) Louis Joseph de Bourbon dit « Louis V Joseph de Condé le Duc » (09/08/1736 à Paris – 13/05/1818 à Chantilly), prince de Condé, grand maître de France, lieutenant-général des armées du Roi, colonel général de l'infanterie, baron de Châteaubriant, fils de Louis Henri de Bourbon dit «Louis IV Henri de Condé » (18/08/1692 à Versailles – 27/01/1740 à Chantilly), prince de Condé, duc de Bourbon, d'Enghien et de Guise, prince de Léon, duc de Bellegarde, comte de Sancerre, baron de Châteaubriant, et de Caroline de Hesse-Rheinfels-Rotenburg (18/08/1714 à Rotenburg an der Fulda – 23/07/1741 à Paris) │ │ │ │ │ │ │ ├──> ? de Rohan-Soubise (1739-1742), comte de Saint-Pol │ │ │ │ │ │ │ x (1741) Anne Thérèse de Savoie-Carignan (01/11/1717 à Paris – 05/04/1745 à Paris), fille de Victor-Amédée Ier de Savoie-Carignan (29/02/1690 à Turin – 04/04/1741 à Turin), prince de Carignan, et de Marie Anne Victoire France de Savoie (1690-1766) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Victoire de Rohan-Soubise dite « Madame de Guéméné » (28/12/1743-20/09/1807 à Paris), princesse de Maubuisson, dame de Clisson │ │ │ │ x (15/01/1761) Henri de Rohan-Guéméné (30/08/1745 à Paris – 24/04/1809 à Prague), prince de Rohan-Guéméné, duc de Montbazon, seigneur de Clisson (voir plus haut) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Eugène de Rohan-Soubise (????-1785), comte de Villafranca │ │ │ │ x ? │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Joseph de Rohan-Soubise (????-1825) │ │ │ │ x ? │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Eugène de Rohan-Soubise (????-1888) │ │ │ │ │ │ │ x (1745) Anna Viktoria Maria Christina von Hessen-Rheinfels Rotenburg (1728-1792), fille de Josef von Hessen-Rheinfels Rotenburg │ │ │ │ │ ├──> François Armand de Rohan-Soubise (01/12/1717 à Paris – 28/06/1756 à Saverne), évêque de Strasbourg, cardinal, membre de l'Académie française │ │ │ │ │ ├──> Marie Louise de Rohan-Soubise dite « Madame de Marsan » (07/01/1720 à Paris – 04/03/1803 à Ratisbonne), comtesse de Marsan, gouvernante des enfants royaux │ │ │ x (04/06/1736 à Paris) Gaston de Lorraine (1721-1743), comte de Marsan et de Walhaim │ │ │ x (relation après 1743) Louis Guillaume Le Monnier (27/06/1717 à Paris – 07/09/1799), botaniste │ │ │ │ │ ├──> François Auguste de Rohan-Soubise (16/09/1721-06/08/1736), comte de Tournon │ │ │ │ │ └──> René de Rohan-Soubise (26/071723-07/02/1743), abbé de Luxeuil │ │ │ ├──> Louise de Rohan-Soubise (1699-1755) │ │ x (1717) Guy Paul Jules de La Porte-Mazarin (1701-1738), duc de Rethel-Mazarin, fils de Paul Jules de La Porte-Mazarin (1666-1731), et de Félicie Charlotte Armande de Durfort-Duras (vers 1672-1730) │ │ │ ├──> Marie Isabelle de Rohan-Soubise (1699-1754) │ │ x (1713) Joseph de La Baume (????-1755) │ │ │ ├──> Louise de Rohan-Soubise (1704-1741) │ │ x (1718) Hercule II Mériadec de Rohan-Guéméné (13/11/1688-21/12/1757 à Sainte-Maure), duc de Montbazon, prince de Guéméné, pair de France (voir plus haut) │ │ │ x (02/09/1732) Marie Sophie Égon de Courcillon (1713-1756), fille de Philippe Égon de Courcillon, et de Sophia de Löwenstein-Wertheim-Rochefort │ ├──> Alexandre de Rohan-Soubise (19/07/1670-09/03/1687) │ ├──> Henri de Rohan-Soubise (04/01/1672-30/07/1693) │ ├──> Armand de Rohan-Soubise (26/06/1674 à Paris – 19/07/1749 à Paris), prince de Rohan, cardinal de Rohan-Soubise, évêque de Strasbourg, membre de l'Académie française, Grand aumônier de France (son vrai père biologique aurait été le roi Louis XIV) │ ├──> Sophronie de Rohan-Soubise (02/07/1678-????) │ x (1694) Alfonso Francisco de Vasconcellos (????-1732), comte de Calhete │ ├──> Éléonore Marie de Rohan-Soubise (25/08/1679-02/11/1753), abbesse à Origny │ ├──> Maximilien de Rohan-Soubise (1680-23/05/1706 à Ramilies) │ ├──> Frédéric de Rohan-Soubise (1682-????) │ x Catherine de Lyonne (????-1660)
Branche de Rohan-Gié

Branche issue des Rohan-Guéméné en 1541. Elle doit son nom à la ville de Gyé-sur-Seine (Aube).
Pierre II de Rohan Gié (†1525) épousa en 1517 Anne de Rohan (1485-1529) héritière de la branche aînée, et devint par ce mariage vicomte de Rohan et de Léon et comte de Porhoët. Son fils, René de Rohan-Gié (1516-1552) épousa en 1534 Isabeau d'Albret dite « Isabeau de Navarre » (1512-1570) et fut père de René, vicomte de Rohan et de Léon († 1586) chef du parti Huguenot en France[2].
Branche éteinte en 1638 avec Henri II de Rohan premier duc de Rohan (1603), marié à Marguerite de Béthune (1595-1660), fille de Maximilien Ier de Béthune-Sully (1559-1641). Sa fille unique Marguerite de Rohan (1617-1684) épousa en 1645 Henri Chabot (1615-1655) et donna naissance à la famille de Rohan-Chabot.
Branche des Rohan-Gié
… │ └──> Louis Ier de Rohan-Guéméné (????-15/12/1457 à Saint-Quentin-les-Anges), seigneur de Guéméné x (07/11/1443) Marie de Montauban[57] (????-1497) │ ├──> Pierre de Rohan-Guéméné dit « Pierre Ier de Rohan-Gié le Maréchal de Gié » (1451 à Saint-Quentin-les-Anges – 22/04/1513 à Paris), seigneur de Gié, vicomte de Fronsac, maréchal de France │ x (1476) Françoise de Penhoët (1455-1498), vicomtesse de Fronsac │ │ │ ├──> Pierre II de Rohan-Gié (????-1525), seigneur de Blain, de Frontenay, de La Marche et de Gié, vicomte de Carentan │ │ x (25/09/1515) Anne de Rohan (1485-05/04/1529 à Blain), vicomtesse de Rohan (voir plus haut) │ │ │ │ │ └──> René de Rohan-Gié dit « René Ier de Rohan » (1516-20/10/1552 à Metz), vicomte de Rohan, prince de Léon, comte de Porhoët, marquis de Blain, seigneur de Beauvoir et de La Garnache, chevalier de l'ordre du Roi et capitaine d'une compagnie d'ordonnance │ │ x (1534) Isabeau d'Albret dite « Isabeau de Navarre » (1512 – vers 1570), infante de Navarre, fille de Jean III d'Albret dit « Jean III de Navarre » (1469-17/06/1516 à Monein), roi de Navarre, et de Catherine de Foix dite « Catherine Ire de Navarre » (1468-12/02/1517 à Mont-de-Marsan), reine de Navarre │ │ │ │ │ ├──> Henri Ier de Rohan (1535-12/06/1575), vicomte de Rohan, comte de Porhoët, prince du sang de Navarre │ │ │ x (15/02/1566) Françoise de Tournemine(????-1609), fille de René de Tournemine, seigneur de La Hunaudaye │ │ │ │ │ │ │ └──> Judith de Rohan (1567-24/06/1575) │ │ │ │ │ ├──> Françoise de Rohan (vers 1540 – à Beauvoir-sur-Mer), dame de La Garnache, duchesse de Loudun et de Nemours │ │ │ x (1557) Jacques de Savoie-Nemours (12/10/1531 à Vauluisant – 15/06/1585 à Annecy), duc de Nemours, fils de Philippe de Savoie-Nemours (1490 à Bourg-en-Bresse – 25/10/1533 à Marseille), duc de Nemours, comte de Genève, et de Charlotte d'Orléans-Longueville (1512-1549) │ │ │ x (1586) François Lesfelle │ │ │ │ │ ├──> René II de Rohan (1550-1586), vicomte de Rohan, prince de Léon, vicomte de Porhoët, seigneur de Pontivy, de Blain de Ploërmel │ │ │ x (1578) Catherine de Parthenay-L'Archevêque (22/03/1554 à Mouchamps – 26/10/1631 à Mouchamps), dame régente de Blain, douairière de Rohan, fille de Jean V de Parthenay-L'Archevêque (1512-01/09/1566 à Mouchamps), seigneur de Mouchamps, et d'Antoinette Henriette Bouchard d'Aubeterre (1535-1580), douairière de Soubise │ │ │ │ │ │ │ ├──> Henriette de Rohan la Bossue (1577-1629) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Catherine de Rohan (1578-1607), duchesse de Deux-Ponts │ │ │ │ x (1604) Jean II de Palatinat-Deux-Ponts (????-1635), duc de Deux-Ponts, comte palatin du Rhin │ │ │ │ │ │ │ ├──> Henri II de Rohan (25/08/1579 à Blain – 28/02/1638 à Genève), vicomte puis duc de Rohan, prince de Léon, seigneur de Blain, prince de Léon, généralissime des armées protestantes, ambassadeur de France, Colonel Général des Suisses et des Grisons │ │ │ │ x (1605) Marguerite de Béthune-Sully (1595-1660), fille de Maximilien Ier de Béthune-Sully (13/12/1559 à Rosny-sur-Seine – 22/12/1641 à Villebon), duc de Sully, ministre de Henri IV, maréchal de France, et de Rachel de Cochefilet (1556-1659) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──> Marguerite de Rohan (1617-09/04/1684 à Paris), duchesse de Rohan et Frontenay, princesse de Léon, comtesse de Porhoët, marquise de Blain et de La Garnache, dame des Lorges, prince de Léon │ │ │ │ │ x (06/06/1645 à Paris) Henri Chabot (vers 1615-27/02/1655 à Chanteloup), seigneur de Jarnac, d'Apremont et de Saint-Aulaye, duc de Rohan, prince de Léon, comte de Porhoët et de Lorges, marquis de Blain et de La Garnache, baron de Mouchamps, seigneur de Héric et de Fresnay (terre en Plessé), gouverneur et lieutenant-général d'Anjou, prince de Léon[86] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Famille de Rohan-Chabot │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──> Tancrède de Rohan (1630-1649 à Paris) (En réalité son père biologique est Louis Charles Nogaret de La Valette de Foix dit « le Beau Candale » (1627-28/01/1658), duc de Candale) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Benjamin de Rohan dit « le Duc de Soubise » (1583-09/10/1642 à Londres), duc de Frontenay, baron de Soubise │ │ │ │ │ │ │ └──> Anne de Rohan (1584-20/09/1646), poétesse │ │ │ │ │ ├──> Jean de Rohan dit « Frontenay » (????-1574) │ │ │ x Diane de Barbançon-Cany │ │ │ │ │ └──> Louis de Rohan, seigneur de Gié │ │ │ ├──> Charles de Rohan-Gié (vers 1478-06/05/1528), seigneur de Gié, vicomte de Fronsac, comte de Guise et d'Orbec │ │ x (24/02/1504) Charlotte d'Armagnac (???? – ), duchesse de Nemours et comtesse de Guise, fille de Jacques d'Armagnac (1733-04/08/1477 à Paris), duc de Nemours, comte de la Marche, et de Louise d'Anjou (1445-1477 à Carlat) │ │ x Giovanna di Sanseverino-Bisignan, fille de Bernardino di Sanseverino (1470-1517), prince de Bisignan, et de Giovanna Eleonora Todeschini Piccolomini │ │ │ │ │ ├──> Jacqueline de Rohan-Gié (1520-1587), dame de Blandy-les-Tours, marquise de Rothelin, princesse de Neuchâtel │ │ │ x (19/06/1536 à Lyon) François IV d'Orléans-Longueville (02/03/1513-25/10/1548), marquis de Rothelin, duc de Longueville, comte de Neuchâtel, prince de Châtellaillon, vicomte de Melun, comte de Tancarville et de Montgommery, baron de Varenguebec, lieutenant de la compagnie de Longueville-sur-Scie, fils de Louis Ier d'Orléans-Longueville (1480-01/08/1516 à Beaugency), comte puis duc de Longueville-sur-Scie, comte de Neuchâtel, marquis de Rothelin, prince de Châtellaillon, comte de Dunois, de Tancarville et de Montgommery, baron de Varenguebec et de Parthenay, vicomte de Melun, capitaine, grand chambellan de France, gouverneur de Provence, et de Johanna von Baden-Hochberg-Neuchâtel (vers 1485-21/09/1543 à Époisses), marquise de Rothelin, comtesse de Neuchâtel, dame de Joux │ │ │ │ │ ├──> François de Rohan-Gié (1515-1559), seigneur de Gié et de Verger, vicomte de Fronsac, comte d'Orbec │ │ │ x (1536) Catherine de Silly, comtesse de Rochefort, fille de Charles de Silly (vers 1477-1518), seigneur de Rochefort-en-Terre, et de Philippa de Commercy (vers 1490-1551), vicomtesse de Louvois │ │ │ x Renée de Rohan-Guéméné (voir plus haut) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Léonore de Rohan-Gié (1539-1583), comtesse de Rochefort │ │ │ │ x (22/07/1561) Louis VI de Rohan-Guéméné (03/04/1540-04/06/1611), prince de Guéméné, comte de Montbazon (voir plus haut) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Jacqueline de Rohan-Gié (????-1578), dame de Gié │ │ │ │ x François de Balzac (????-1613), seigneur d'Entragues │ │ │ │ │ │ │ └──> Françoise Diane de Rohan-Gié (????-1585), dame de Gillebourg │ │ │ x (1564) François de Maillé de La Tour-Landry (????-1598), comte de Châteauroux │ │ │ │ │ └──> Claude de Rohan-Gié, comtesse de Thoury │ │ x (1537) Claude de Beauvilliers (????-1540) │ │ x Julien de Clermont-Tonnerre, fils de Bernardin de Clermont (1440-1522), vicomte de Tallard, seigneur de Saint-André-en-Royans, et d'Anne de Husson (1475-1540), comtesse de Tonnerre │ │ │ ├──> François II de Rohan-Gié (1480-13/10/1536 à Paris), archevêque de Lyon, évêque d'Angers │ │ │ x (1503) Marguerite d'Armagnac (????-1503), comtesse de Guise, fille de Jacques d'Armagnac-Nemours │ └──> Hélène de Rohan-Guéméné (????-1507) x Pierre du Pont (????-
Branche de Rohan-Gué-de-l'Isle

Branche issue vers 1270 d'Alain VI de Rohan (1232-1304), vicomte de Rohan et Thomasse de La Roche-Bernard (vers 1245 – après 1304). Nommée d'après la terre de Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle (Côtes-d'Armor). Ils sont à l'origine de la première imprimerie en Bretagne (1484) à Bréhan-Loudéac[87].
Branche éteinte vers 1530.
Branche des Rohan-Gué-de-l'Isle
… │ └──> Alain VI de Rohan (1232-1304), vicomte de Rohan x Isabeau d'Avaugour (????-1266) x (1266) Thomasse de La Roche-Bernard[38] (vers 1245 – après 1304) │ └──> Eudon de Rohan dit « Eudon de Rohan-Gué-de-l'Isle » (???? – après 1346), seigneur du Gué-de-l'Isle x Aliette de Coëtlogon, dame du Gué-de-l'Isle │ ├──> Richarde de Rohan-Gué-de-l'Isle │ x Éon de Treal et du Gouray │ └──> Olivier Ier de Rohan-Gué-de-l'Isle (????-1410) x Alaine de Botdevenu x Havisette de La Châtaigneraie │ ├──> Jeanne de Rohan-Gué-de-l'Isle │ x Jean du Cambout (????-1428) │ ├──> Isabeau de Rohan-Gué-de-l'Isle (????-1434) │ x Alain de Beaumont │ ├──> Catherine de Rohan-Gué-de-l'Isle │ x Alain du Thou │ └──> Olivier II de Rohan-Gué-de-l'Isle (????-1463) x Marie de Rostrenen (????-1471) │ ├──> Olivier III de Rohan-Gué-de-l'Isle │ ├──> Catherine de Rohan-Gué-de-l'Isle │ x Georges Chesnel │ ├──> Yolande de Rohan-Gué-de-l'Isle │ x (1463) Guillaume Le Sénéchal (????-1505) │ ├──> Jeanne de Rohan-Gué-de-l'Isle │ x Jean de Ramé │ ├──> Jeanne de Rohan-Gué-de-l'Isle │ x Jean de La Touche-Limouzinière, seigneur de La Touche-Limouzinière │ ├──> Marie de Rohan-Gué-de-l'Isle │ x (1450) Caro de Bodegat, seigneur de Bodegat │ └──> Jean Ier de Rohan-Gué-de-l'Isle[88] (????-1493) x (1453) Gilette de Rochefort │ ├──> François de Rohan-Gué-de-l'Isle │ x Jacquette de Peillac │ │ │ ├──> Vincente de Rohan-Gué-de-l'Isle, dame de Peillac │ │ x Maurice de Plusquellec │ │ │ ├──> Cyprienne de Rohan-Gué-de-l'Isle │ │ x François de La Feillée (????-1538), vicomte de Pléhédel │ │ │ x Adelise de Juch │ └──> Jean II de Rohan-Gué-de-l'Isle (????-1517) x (1500) Guillemette Malor │ ├──> Gillette de Rohan-Gué-de-l'Isle (1500-1530) │ x (1521) Marc de Carne (????-1553) │ ├──> Ponceau de Rohan-Gué-de-l'Isle │ x (1514) Madeleine Boissot │ ├──> Tristan de Rohan-Gué-de-l'Isle dit « Tristan de Rohan-Polduc » │ x Alix de Brebant │ │ │ └──> branche de Rohan-Polduc │ ├──> Jeanne de Rohan-Gué-de-l'Isle │ x (1526) Pierre Ermar │ x Françoise Laurens
Branche de Rohan-Polduc

Ou Rohan-Pouldu. Rameau peu connu, issu vers 1500 des Rohan-Gué-de-l'Isle. Nommé d'après la terre du Pouldu près de Pontivy (aujourd'hui commune de Saint-Jean-Brévelay). Le plus connu est Emmanuel de Rohan-Polduc, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de 1775 à 1797, la branche s'éteint en 1800.
Branche de Rohan-Polduc
- Jean II de Rohan-Gué-de-l'Isle (????-1517)
+ (1500) Guillemette Malor- Tristan de Rohan-Gué-de-l'Isle dit « Tristan de Rohan-Polduc »
+ Alix de Brebant- Louis de Rohan-Polduc (????-1584)
+ (1577) Michelle de L'Hospital- Samsonne de Rohan-Polduc
+ François Josset - Jérôme de Rohan-Polduc
+ (1610) Julienne Le Métayer- Anne de Rohan-Polduc
+ (1638) Jean de Coëtlagat - Isaac de Rohan-Polduc
+ (1638) Aliénor de Kerpoisson- Anne de Rohan-Polduc
+ François de Broel - Jean de Rohan-Polduc (????-1726)
+ (1690) Marie de Trello - Jean-Baptiste Ier de Rohan-Polduc (????-1711)
+ (1690) Pélagie Martin, dame de Châteaulin- Jean-Baptiste II de Rohan-Polduc (1675-1755)
+ (1723) Marie Louise de Velthoven- Jean-Baptiste de Rohan-Polduc (1724-1782))
- Marie Pélagie de Rohan-Polduc (1724-1753)
+ (1737) François de Groesquer, comte de Groesquer - Emmanuel de Rohan-Polduc (18/04/1725-14/07/1797 à La Valette), ambassadeur, général des galères, bailli de Justice, général des forces terrestres et navales, chevalier de Malte, grand maître des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
- Jean Léonard de Rohan-Polduc (????-1748)
- Jean-Baptiste II de Rohan-Polduc (1675-1755)
- Anne de Rohan-Polduc
- Anne de Rohan-Polduc
- Samsonne de Rohan-Polduc
- Louis de Rohan-Polduc (????-1584)
- Tristan de Rohan-Gué-de-l'Isle dit « Tristan de Rohan-Polduc »
Branche de Rohan-Montauban

La branche de Rohan-Montauban serait issue vers 1185 d'Alain III de Rohan et de Françoise de Corbey, mais dont la filiation n'est pas prouvée. Elle s'éteint vers 1535. Nommée d'après la terre de Montauban-de-Bretagne près de Rennes. Elle compte notamment des sénéchaux et des maréchaux de Bretagne. Un Robert devint en 1415 bailli de Cotentin, et resté fidèle au roi de France, il participa en 1429 au siège d'Orléans[89].
Branche éteinte en 1494 dans la branche Rohan-Guéméné.
Remove ads
Maison de Rohan-Chabot
La maison de Rohan-Chabot est la branche ainée de la famille de Chabot, originaire du Poitou. Elle est également issue en ligne féminine de la maison de Rohan par le mariage en 1645 de Marguerite de Rohan (1617-1684) (fille unique et héritière d'Henri II de Rohan, duc de Rohan) avec Henri Chabot (1616-1655), de la branche ainée Chabot de Jarnac. Henri Chabot fut créé duc de Rohan en 1648 par Louis XIV, et sa descendance agnatique porte le nom Rohan-Chabot.
Remove ads
Portraits
- Marguerite de Rohan (1335-1406) et son mari le connétable de Clisson.
- Pierre de Rohan-Guéméné dit le maréchal de Gié (1451-1513), maréchal de France.
- Jacqueline de Rohan-Gié (1520-1587), dame de Blandy-les-Tours, marquise de Rothelin, princesse de Neuchâtel.
- Claude de Rohan-Gié, comtesse de Thoury
- Henri II de Rohan (1579-1638) vicomte puis duc de Rohan, prince de Léon, généralissime des armées protestantes, ambassadeur de France, Colonel général des Suisses et des Grisons.
- Benjamin de Rohan dit « le duc de Soubise» (1583-1642) duc de Frontenay.
- Marie Aimée de Rohan-Guéméné (1600-1679), duchesse de Luynes et de Chevreuse.
- Marguerite de Rohan (1617-1684), princesse de Léon.
- Louis de Rohan-Guéméné dit « le Chevalier de Rohan » (1635-1674), grand veneur de France, colonel des gardes de Louis XIV.
- Armand Gaston Maximilien de Rohan-Soubise (1674-1749) prince de Rohan, prince de Soubise, évêque de Strasbourg cardinal, membre de l'Académie française, grand aumônier de France.
- Armand Jules de Rohan-Guémené (1695-1762) archevêque-duc de Reims et pair de France.
- Louis César Constantin de Rohan-Guéméné dit « le Cardinal de Rohan » (1697-1779), évêque de Strasbourg, cardinal.
- Charles de Rohan-Soubise dit «le Maréchal de Soubise » (1715-1787) prince de Soubise, duc de Rohan-Rohan, ministre des rois Louis XV et Louis XVI, maréchal de France.
- Charlotte Louise de Rohan-Guéméné, princesse de Masseran, dite « Mademoiselle de Rohan » (1722-1786).
- Emmanuel de Rohan-Polduc (1725-1797), ambassadeur, général des galères, chevalier de Malte, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
- Louise de Rohan-Rochefort (1734-1815).
- Louis René Édouard de Rohan-Guéméné (1734-1803, prince de Rohan, cardinal, archevêque de Strasbourg, membre de l'Académie française, grand aumônier du roi et proviseur de la Sorbonne.
- Charlotte de Rohan-Soubise (1737-1760), princesse de Condé.
- Victoire Armande Josèphe de Rohan-Soubise dite « Madame de Guéméné » (1743-1807), princesse de Maubuisson.
- Charles Alain Gabriel de Rohan-Guéméné (1764-1836), duc de Montbazon, prince de Guéméné, duc de Bouillon.
- Charlotte de Rohan-Rochefort (1767-1841), épouse du duc d'Enghien.
- Jules Armand Louis de Rohan-Guémené (1768-1836).
- Marie Victoire de Rohan (1779-1836).
- Gasparine de Rohan-Rochefort (1798-1871), princesse de Reuss-Greiz.
Remove ads
Personnalités
Résumé
Contexte
Au XVIIIe siècle, quatre cardinaux de Rohan se succédèrent sur le trône épiscopal de Strasbourg :
- Armand-Gaston Maximilien de Rohan-Soubise (1674-1749) (peut-être en réalité fils naturel de Louis XIV), grand aumônier de France,
- Louis-Constantin de Rohan-Guéméné (1697-1779),
- François-Armand de Rohan-Soubise (1717-1756),
- Louis-René de Rohan-Guéméné (1734-1803), grand aumônier du roi et proviseur de la Sorbonne.
- Marie-Louise de Rohan Soubise (1720-1803), comtesse de Marsan, gouvernante des enfants de France : les petits enfants de Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII, Charles X.
Deux autres ecclésiastiques de Rohan se distinguèrent également à cette époque :
- Armand-Jules de Rohan-Guémené (1695-1762), archevêque-duc de Reims, qui sacrera Louis XV),
- Ferdinand de Rohan-Guéméné (1738-1813), archevêque de Bordeaux puis archevêque de Cambrai, qui sera au début du XIXe siècle premier aumônier de l'impératrice Joséphine de Beauharnais. À la veille de la Révolution française, Henri-Louis de Rohan-Guéméné (1745-1809), prince de Rohan-Guéméné et duc de Montbazon, l'aîné de cette branche, réalisa une colossale faillite qui ruina bien des gens en 1782 mais qui fut épongée, en partie par le cardinal de Strasbourg Louis-René-Édouard de Rohan-Guéméné qui sera en 1785 victime de l'escroquerie de l'affaire du collier de la reine.
Certains membres de la famille Rohan-Guéméné émigrèrent en Autriche, s'implantant au Palais Rohan, à Prague, au château de Sychrov en Bohême du Nord, où ils furent naturalisés. À leur extinction en 1846, la branche cadette des princes de Rohan-Rochefort hérite des biens en Bohême dont ils sont privés en 1945, à la suite des décrets Beneš. Ils héritent aussi des titres d'altesse sérénissime, prince de Rohan, de Guéméné, de Rochefort et du Saint-Empire (en Autriche jusqu'en 1919), duc de Rohan-Rohan, duc de Montbazon avec la pairie de France qui y est attachée, et de duc de Bouillon.
La famille compte trois grands aumôniers de France, huit chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit, deux maréchaux de France, trois académiciens.
- Ecclésiastiques
- Geoffroy II de Rohan (? – v. 1377), évêque de Vannes puis de Saint-Brieuc.
- Josselin de Rohan (? - Saint-Malo, ), évêque de Saint-Malo.
- François II de Rohan-Gié (1480 - Paris, ), évêque d'Angers (1501-1532) et archevêque de Lyon (1532-1536).
- Claude de Rohan (1480 - ), évêque de Quimper et de Cornouaille.
- Armand-Gaston-Maximilien de Rohan-Soubise (Paris, – Paris, ), prince de Rohan, évêque de Strasbourg en 1704, il devint cardinal en 1712, puis grand aumônier en 1713. Il fut élu à l'Académie française en 1704.
- Armand-Jules de Rohan-Guéméné (Paris, – Saverne, ), abbé du Gard et de Gorze, archevêque-duc de Reims qui sacrera Louis XV, pair de France
- Louis-César Constantin de Rohan-Guéméné dit « le Cardinal de Rohan » (Paris, – Paris, ), évêque de Strasbourg en 1756, nommé cardinal en 1761.
- François-Armand de Rohan-Soubise (Paris, – Saverne, ), fut coadjuteur de son oncle Armand-Gaston et prit le nom de Soubise pour se distinguer de lui ; cardinal lui-même en 1747, il devint évêque de Strasbourg en 1749. Il fut aussi grand aumônier et recteur de l'Université de Paris. Il fut élu à l'Académie française en 1741.
- Louis-René-Édouard de Rohan-Guéméné (Paris, – Ettenheim, ), prince de Rohan, cardinal-archevêque de Strasbourg, grand aumônier du roi et proviseur de la Sorbonne. Il fut impliqué dans l'affaire du collier de la reine qui lui valut un séjour à la Bastille. Il s'exila en 1791 à Ettenheim dans la partie allemande de son diocèse où il maria sa nièce Charlotte de Rohan-Rochefort et le duc d'Enghien. Il mourut en . Il fut élu à l'Académie française en 1761.
- Ferdinand-Maximilien-Mériadec de Rohan-Guéméné (Paris, - Paris, ), prince de Rohan-Guéméné, archevêque de Bordeaux en 1769, prince-archevêque de Cambrai (1781) et de Liège (1790), il fut premier aumônier de l'impératrice Joséphine de Beauharnais.
- Militaires
- Pierre de Rohan-Guéméné dit « Pierre Ier de Rohan-Gié le Maréchal de Gié » (Saint-Quentin-les-Anges, 1451 – Paris, ), seigneur de Gié, vicomte de Fronsac, maréchal de France. Diplomate, il fut conseiller des rois Louis XI, Charles VIII et Louis XII. En 1504 il est accusé de trahison. En 1506, Pierre de Rohan-Gié est suspendu de son office pour cinq ans et exilé de la cour. Il est absous par la suite du crime de lèse-majesté.
- Henri II de Rohan (Blain, – Genève, ), vicomte puis duc de Rohan, prince de Léon, seigneur de Blain, prince de Léon, généralissime des armées protestantes, ambassadeur de France, colonel général des Suisses et des Grisons. Calviniste, il lutta dans le midi de la France contre les troupes royales entre 1615 et 1629. Rentré en grâce auprès de Louis XIII, il enleva la Valteline aux Espagnols et fut mortellement blessé au service du duc de Saxe-Weimar.
- Louis de Rohan-Guéméné dit « le chevalier de Rohan » (1635 - Paris, ), Grand veneur de France, colonel des gardes de Louis XIV avec lequel il avait été élevé. Exécuté pour crime de lèse-majesté ayant participé au complot de Latréaumont.
- Charles de Rohan-Soubise dit « le maréchal de Soubise » (Versailles, – Paris, ), prince de Soubise et d'Épinoy, duc de Rohan-Rohan, de Ventadour et de Goëlo, comte de Saint-Pol, seigneur de Roberval et de Clisson, ministre des rois Louis XV et Louis XVI, maréchal de France. Général et ami du roi Louis XV, il participa à la guerre de Sept Ans.
- François Armand de Rohan Guéméné (4 décembre 1682 - 26 juin 1717), brigadier des armées du Roi ;
- Hercule Mériadec de Rohan ( - ), duc de Montbazon, prince de Guémené, guidon des gendarmes de la Garde.
- Charles de Rohan Rochefort (7 août 1693 - 25 février 1763), prince de Rochefort, lieutenant-général des armées du Roi :
- Jules Hercule Mériadec de Rohan ( - ), duc de Montbazon, prince de Guémené, lieutenant-général des armées du Roi ;
- Charles Jules de Rohan Rochefort (29 août 1729 - 18 mai 1811), lieutenant général des armées du Roi ;
- Henri Louis Marie de Rohan ( - ), duc de Montbazon, prince de Guéméné, capitaine lieutenant des Gendarmes de la Garde, brigadier des armées du Roi, grand chambellan de France, et son épouse, née Victoire de Rohan Soubise (28 décembre 1743 - 20 septembre 1807) ;
- Louis Victor Meriadec de Rohan (20 juillet 1766 - 10 décembre 1846), émigré en 1791, Feldmarschall-Leutnant de l'empire d'Autriche.
- Politiques
- Jean II de Rohan ( - Blain, ), vicomte de Rohan et de Léon, comte de Porhoët, seigneur de Blain, de La Garnache et de Beauvoir-sur-Mer, conseiller et chambellan du roi Charles VIII, lieutenant général de Bretagne en 1494 avec François d'Avaugour sous Charles VIII.
- Marie-Aimée de Rohan-Guéméné (Coupvray, – ), d'abord duchesse de Luynes par son mariage avec Charles d'Albert (1578–1621), duc de Luynes, connétable de France, pair de France, puis duchesse de Chevreuse (nom sous lequel elle est le plus connue) par son mariage avec Claude de Lorraine dit « Claude de Guise » (1578-1657), duc de Chevreuse, enfin dite princesse de Chevreuse pendant son veuvage.
- Charles III de Rohan ( - ), duc de Montbazon, prince de Guémené, pair de France.
- Emmanuel-Marie-des-Neiges de Rohan-Polduc ( - La Valette, ), dernier de la branche des Rohan-Polduc (ou Pouldu), fut l'avant-dernier grand maître des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de 1775 à 1797[90], rédacteur du "Code maltais" dit aussi "Code de Rohan".
- Alain Benjamin Arthur de Rohan-Rochefort ( - ), duc de Montbazon, duc de Bouillon, prince de Guémémé, membre de la Chambre des Seigneurs d'Autriche, député au Parlement de Bohème.
- Marie-Berthe Françoise Félicie Jeanne de Rohan-Rochefort ( - ), épouse de Charles de Bourbon (1848-1909), duc de Madrid, aîné de la Maison de Bourbon.
- Albert-Marie de Rohan-Rochefort dit « Albert Rohan » (Melk, - )[91],[92],[93], duc de Montbazon, prince de Guémené, diplomate autrichien.
- Personnalités féminines
- Charlotte de Rohan Soubise (7 octobre 1737 - 1760), princesse de Condé ;
- Victoire de Rohan Soubise (28 décembre 1743 - 20 septembre 1807), princesse de Guéméné ;
- Charlotte de Rohan Rochefort (25 octobre 1767 - 1er mai 1841), compagne du duc d'Enghien ;
- Gasparine de Rohan-Rochefort (29 septembre 1798 - 27 juillet 1871), épouse en 1822 Henri XIX de Reuss-Greiz et devient dès lors princesse consort de la principauté de Reuss branche aînée.
Remove ads
Armes
Résumé
Contexte
Les macles du blason de la maison de Rohan font référence à des macles, qui sont des grands cristaux de chiastolite (andalousite) qui sont développés dans les schistes ordoviciens. Ils se présentent en prismes de section presque carrée. Ces pierres, appelées pendant des siècles "macles", sont abondantes aux Salles de Rohan, à tel point que les vicomtes de Rohan, frappés par leur beauté et la similitude avec la macle héraldique, placèrent sept macles d'or sur leur blason ; leurs descendants en ajoutèrent deux supplémentaires à partir du milieu du XVIe siècle[94].
- Armes anciennes
 |
Blasonnement :
Commentaires : Armes (anciennes) des Rohan (adoptées par Geoffroy de Rohan entre 1216 et 1222). |
- Armes modernes
 |
Blasonnement :
Commentaires : Armes (modernes) des Rohan (adoptées par Henri Ier de Rohan entre 1552 et 1575). Le passage des armes anciennes aux armes modernes s'explique aisément par la modification de la forme des écus à partir du XIVe siècle : la pointe s'aplatit, l'espace vide ainsi créé est comblé par deux nouvelles macles. |
- Devise
« A plus » (cri de guerre qui peut signifier « sans plus », à savoir sans supérieur, rappelant la prétention des Rohan à être la deuxième famille de la noblesse bretonne après la famille ducale, ou « encore au-delà », ce qui serait une invitation au surpassement permanent de soi[95]) est la devise personnelle d'Alain IX de Rohan, souvent attribuée à l'ensemble de la maison. Elle est symbolisée par la lettre A surmontée d'une couronne ducale qui accompagne les macles du blason[96].
Une autre devise apocryphe, modelée sur celle des seigneurs de Coucy, est souvent attribuée aux Rohan : « Duc je ne daigne, Roi je ne puis, Prince de Bretaigne, de Rohan je suis » (plus couramment : « Roi ne puis, duc ne daigne, Rohan suis »[97][réf. à confirmer]). Sur ce modèle, Roland Barthes se laissera aller à badiner[98] : « Tout écrivain dira donc : “Fou ne puis, sain ne daigne, névrosé je suis.” ».
Également : « Plutôt la mort que la souillure » i.e. « Potius mori quam foedari » qui est la devise des anciens ducs de Bretagne dont les Rohan sont les héritiers présomptifs depuis 1532 et le traité d'"Union perpétuelle" de la Bretagne et de la France.
Remove ads
Titres

La famille de Rohan porta d'abord les titres féodaux de vicomte de Porhoët puis de Rohan et reçut les titres suivants :
- Comte de Montbazon (1566)
- Prince de Guémené (1570)
- Duchesse de Loudun (1579) titre viager pour Françoise de Rohan, fille de René Ier de Rohan[99]
- Duc-pair de Montbazon (1588 et 1594)
- Duc de Rohan (1603)
- Comte de Montauban (1611)
- Duc-pair de Frontenay (1626, non enregistré)
- Prince de Soubise (érigé en 1667 mais non enregistré)
- Duc de Rohan-Rohan (1714, éteint en 1787)
- Comte de l'Empire (1808)
- Pair de France (1814)
- Pair héréditaire (1815)
- Duc pair (1817)
- Prince de Rohan et altesse sérénissime (Autriche 1808 et 1830)
- Duc de Bouillon (1814 et 1816 par succession de la maison de La Tour d'Auvergne)
Ses diverses branches prirent les titres de prince de Léon, prince de Montauban, prince de Rochefort etc. sans que ces titres ne fissent l'objet d'une création authentique[100].
Remove ads
Propriétés


- Château de Belvoir ( Bourgogne-Franche-Comté), domaines du Comté de Bourgogne.
- Château de Rohan à Saverne (aujourd'hui un musée)
- Palais Rohan à Strasbourg pour les princes-évêques (qui abrite aujourd'hui trois musées)
- Palais épiscopal de Bordeaux (aujourd'hui la mairie)
- Château de Josselin (Morbihan)
- Château de Pontivy (Morbihan)
- Château de La Roche-Maurice (Finistère)
- Château de Joyeuse-Garde à La Forest-Landerneau (Finistère)
- Château de Mortiercrolles à Saint-Quentin-les-Anges(Mayenne)
- Château du Verger à Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire)
- Château de Blain (Loire-Atlantique)
- Château du Gué-de-Lisle (Côtes-d'Armor)
- Château de Coupvray (Seine-et-Marne)
- L'hôtel de Rohan à Soubise (aujourd'hui la mairie)
- Château de Rochefort-en-Yvelines (Yvelines)
- Château de Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire)
- Château de Sychrov (Bohême)
- Palais Rohan à Prague (République tchèque)
- Palais Rohan à Vienne (Autriche)
- L'hôtel de Rohan (dit aussi hôtel de Rohan-Strasbourg, car il était la résidence des membres de la famille évêques de cette ville — voir supra : les ecclésiastiques) et l'hôtel de Soubise, à Paris, au Marais, formant un ensemble qui accueille aujourd'hui une partie des Archives nationales.
- L'hôtel de Rohan-Guémené, également connu sous le nom de maison de Victor Hugo (qui n'en habita qu'une petite partie) se situe au 6, place des Vosges et s'étendait à la rue des Tournelles et à l'impasse Guéménée.
- L'hôtel de Rohan-Montbazon, 29, rue du Faubourg-Saint-Honoré.
- L'hôtel de Soubise à Saint-Germain-en-Laye, aujourd'hui café Le Soubise.
- Château de Vigny
Remove ads
Voir aussi
Bibliographie
- Jonathan Dewald (trad. de l'anglais par Patrick Galliou), La famille Rohan, 1550-1715 : statut, pouvoir et identité dans la France du début de l'époque moderne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 282 p. (ISBN 9782753595910).
- Suzanne d'Huart, Archives Rohan-Bouillon, Inventaire, 1970, Paris, Archives Nationales, 246 p., tableaux généalogiques (répertoire imprimé de la sous-série 273 AP, aux Archives Nationales) [101],[102].
- Dominique de Lastours, "Cambourg, Itinéraires Bretons", 2019, Editions Lampsaque, 850 pages. Prix Histoire (Texier II) 2020, de L'Académie des Sciences morales & politique (Institut de France) (ISBN 2-911825-23-3) .
- Georges Martin, Histoire et généalogie de la Maison de Rohan, 1998, Lyon, l'auteur, 1 vol. in 8°, 256 p. ill.
- Yvonig Gicquel, Alain IX de Rohan un grand seigneur de l'Âge d'Or de la Bretagne, 1986.
- Yvonig Gicquel, Jean II de Rohan ou l'indépendance brisée de la Bretagne, éd. Jean Picollec, Paris, 1994.
- Alain Boulaire, Les Rohan, éd. France-Empire, 2001.
- Bertrand Galimard Flavigny, Histoire de l'ordre de Malte, Paris, Perrin, 2005 (ISBN 2-262-02115-5).
- Claude Muller, Le siècle des Rohan : une dynastie de cardinaux en Alsace au XVIIIe siècle, éd. La Nuée bleue, Strasbourg, 2006.
- Jean-Claude Fauveau, Le Prince Louis Cardinal de Rohan-Guéméné ou les diamants du roi, L'Harmattan, 2007.
- Éric Mension-Rigau, Les Rohan : histoire d'une grande famille, Paris, Perrin, , 319 p. (ISBN 978-2-262-06775-5, présentation en ligne).
Articles connexes
Liens externes
Notes et références
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads